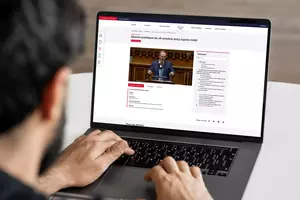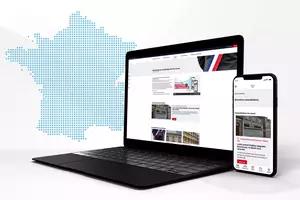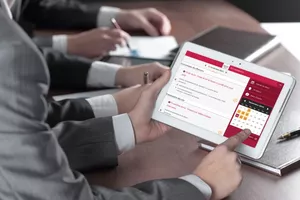M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, un gouvernement qui décide seul devrait assumer seul !
Cette décision solitaire s’est manifestée par la multiplication des 49.3 sur les projets de lois de finances et de loi de programmation des finances publiques. Les oppositions avaient raison : cette programmation était caduque avant même son adoption, elle est désormais dans un carton à Bercy ; toutes les projections macroéconomiques et les trajectoires de réduction de déficits qu’elle comportait ont volé en éclats.
Décider seul, c’est aussi refuser de reconnaître que la politique de l’offre est une impasse.
Les entreprises sont abreuvées d’argent public ; les dépenses de l’État ont progressé de 100 milliards d’euros depuis 2019 ; la croissance est atone ; les chiffres de l’emploi sont artificiellement gonflés par le million d’apprentis subventionnés ; la réindustrialisation serait à l’œuvre, mais la balance commerciale ne cesse de dévisser.
Les entreprises se gavent de crédit d’impôt recherche, l’une des 465 niches fiscales – leur montant total est de 94,2 milliards d’euros pour les finances publiques –, mais Sanofi a supprimé dix mille postes depuis 2018, dont trois cent trente dans la recherche.
En 2024, vous créez un crédit d’impôt pour l’industrie verte – dont acte ! –, mais, si l’entreprise Systovi menace de mettre la clé sous la porte, ce n’est pas la fiscalité qui est en cause. Une niche fiscale supplémentaire ne lui apportera donc pas de réponse.
La fin de la concurrence mondiale, la mise en place de barrières douanières européennes, de clauses de réciprocité, de protections, en somme, la fin du libre-échange débridé, voilà les attentes des entreprises.
Serons-nous un jour « compétitifs », pour reprendre vos termes, face à la Chine ? Cela ne nous empêche pas d’être plus intelligents.
Cette année, 100 000 emplois devraient disparaître, avec la fin de la conjoncture post-covid ; 68 000 défaillances d’entreprises sont attendues, alors que la marée des prêts garantis par l’État se retire. Le taux de chômage devrait s’établir à 8,4 % en fin d’année, alors qu’il est à 6 % dans l’Union européenne. La politique de l’offre n’ouvre décidément aucune perspective.
Décider seul, c’est croire, enfin, que les finances publiques pourront se redresser sans améliorer les recettes publiques. Vous avez repoussé toutes nos mesures d’économies sur les niches des plus riches comme toutes nos mesures fiscales pour rétablir de l’équité.
Nous proposons de taxer les superdividendes. Une mesure en ce sens a été adoptée en projet de loi de finances, mais a reçu une fin de non-recevoir du ministre Bruno Le Maire. Selon lui, il faut faire attention en augmentant l’imposition sur les dividendes, car on aurait le sentiment de frapper les riches alors que l’on toucherait les salariés actionnaires. Il est même allé jusqu’à parler de « supercherie ».
Rétablissons les faits : les 2,6 millions de salariés actionnaires perçoivent en moyenne un peu plus de 1 000 euros en dividendes par an. Ils ne seraient donc pas concernés. En revanche, selon France Stratégie, 0,78 % des Français raflent 94 % de l’ensemble des 63 milliards d’euros de dividendes distribués.
Nous proposons de taxer les rachats d’actions. Le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky a fait adopter au Sénat, avec le groupe Union Centriste, un amendement à cette fin lors de l’examen du dernier projet de loi de finances, que vous avez également balayé, monsieur le ministre. Mais voilà que le Premier ministre annonce, quelques mois après cette fin de non-recevoir, qu’il est envisageable de taxer ce type d’opérations !
Vous voulez décider seul contre les oppositions, en feignant d’organiser des « dialogues de Bercy », des comités de concertation… Mais le débat parlementaire se tient ici, dans les hémicycles des assemblées, à visage découvert, là où chacun peut prendre ses responsabilités.
Allons vers un projet de loi de finances rectificative et nous verrons qui propose quoi, qui vote quoi. Vous voulez éviter le débat avec les parlementaires ; vous avez si peur d’avoir raison avec nous que vous préférez avoir tort seul. Alors vous prévoyez, dans le programme de stabilité, des économies de 27 milliards d’euros en 2025, que vous n’avez pas étayées, qui sont d’une brutalité inouïe et dont personne ne veut, car la confiance est rompue.
Nous ne vous en accordions guère, quant à nous, mais même votre partenaire s’impatiente. Un des symptômes de cette situation est bien que le ministre chargé des finances et le Président de la République débattent dans la presse, l’un préférant considérer le niveau des dépenses, l’autre les recettes en diminution.
M. le ministre Bruno Le Maire, en présentant en septembre dernier le projet de loi de finances pour 2024, annonçait vouloir réduire la dépense publique de 16 milliards d’euros et décidait en même temps – dans le même texte ! – d’emprunter 285 milliards d’euros sur le marché financier privé, un montant historique. Cette année, nous paierons d’ailleurs aux acteurs financiers concernés 52 milliards d’euros d’intérêts !
L’urgence, messieurs les ministres, est de rétablir la souveraineté fiscale et budgétaire de notre République ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K et sur des travées des groupes SER et GEST.)
M. le président. La parole est à M. Raphaël Daubet. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Raphaël Daubet. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, « instabilité », ce terme eût été mieux choisi pour qualifier le programme dont nous débattons, tant la trajectoire que nous suivons depuis un certain temps déjà se caractérise par l’incertitude des prévisions de croissance, par l’insécurité géopolitique et par la fragilité économique de nombreux ménages.
Au fond, le principal problème de ce programme est qu’il n’a pas été écrit à partir de la réalité économique, mais à partir d’objectifs, ceux de Maastricht, vers lesquels nous entendons converger.
Je ne me fais guère d’illusions sur l’utilité de ce débat non plus que sur sa capacité à infléchir les choix du Gouvernement. Néanmoins, je le crois important, car mon groupe politique est très attaché au projet européen, aussi perfectible soit-il dans sa traduction concrète.
Je le crois important, également, à un moment où l’état de nos finances publiques prend une dimension politique qui dépasse largement les seules controverses des économistes.
Le coût exorbitant de la crise sanitaire, les révélations sur le déficit de 2023 – avec 21 milliards d’euros de recettes en moins –, les prévisions de croissance invraisemblables et finalement fausses, la dette publique en passe de devenir le premier poste de dépenses de l’État : dans un tel contexte, l’inquiétude et le sentiment d’insécurité des Français ne sauraient être négligés.
Ce que nous attendons du dialogue – sincère, pour le coup ! – que vous devriez avoir avec la représentation nationale, c’est la démonstration que l’orientation de nos finances publiques n’est pas un exercice comptable, mais bien un projet politique pour la Nation. Quel sens prendront la revue des dépenses ou la recherche de nouvelles recettes ?
Bien sûr, le groupe RDSE se réjouit que la note de la France n’ait pas été dégradée par les agences Fitch et Moody’s. Force est de constater que la politique de soutien à l’activité a porté ses fruits et l’honnêteté intellectuelle, au vu des chiffres, commande de reconnaître que le chômage est au plus bas depuis quarante ans et que la réindustrialisation du pays a commencé.
Pour autant, le projet politique que nous attendons désormais est celui du redressement et de la consolidation de notre modèle social et républicain, lequel est, ne l’oublions pas, un facteur majeur de notre résilience économique. Ce n’est pas moi qui le dis, mais des chefs d’entreprise de mon département.
Ce modèle rassure les investisseurs et donne de la stabilité – c’est bien le mot ! – à notre économie. La crise sanitaire l’a d’ailleurs illustré.
Cette consolidation pose évidemment la question des réformes et celle de l’efficacité de nos politiques publiques, car la dépense ne résout pas tout.
La trajectoire des finances publiques que nos concitoyens attendent, toutefois, c’est celle qui va redresser l’école de la République, qui va redonner accès aux soins à tous les Français, qui va sauver l’hôpital de la faillite ou encore qui va rétablir la justice fiscale.
En résumé, messieurs les ministres, vous nous présentez un itinéraire bis : même cap, même destination, mais la pente promet d’être raide. Vous comptez sur une croissance du PIB supérieure à celle que projettent tous les prévisionnistes réunis. Cette ambition n’est pas hors d’atteinte, selon le Haut Conseil des finances publiques, mais elle est optimiste.
Vous misez sur le recul de l’inflation pour relancer la consommation des ménages. Je m’inquiète, pour ma part, du cap du million d’interventions pour impayés de factures d’électricité, franchi en 2023 : le médiateur national de l’énergie nous alerte sur le doublement de ses interventions pour ce motif depuis 2019. Dans ces conditions, je ne suis pas certain que la confiance des ménages soit acquise.
Par ailleurs, vous pariez sur la relance des investissements des entreprises, à l’heure où de nombreuses PME peinent à rembourser leur prêt garanti par l’État. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, au début du mois de janvier, votre ministère leur a permis de repousser leurs échéances, à l’amiable.
Reste, enfin, que les économies engagées par les annulations de crédits et le gel des réserves de précaution ne constituent pas une réforme structurelle, mais s’apparentent plutôt à un tour de vis dans le fonctionnement des ministères. Il s’agit d’une solution d’urgence et non d’avenir. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce début d’année 2024 nous a apporté son lot de mauvaises nouvelles économiques et budgétaires : une croissance pour 2023 légèrement plus faible que prévu – 0,9 % – et, surtout, un déficit budgétaire pour 2023 plus important que prévu – 5,5 % du PIB –, poussant notre dette à 110,6 % du PIB.
Paradoxalement, cette dégradation du déficit public est en partie liée à une bonne nouvelle : le reflux de l’inflation. En effet, ce n’est pas un dérapage des dépenses publiques qui en est à l’origine, mais principalement une moindre rentrée de recettes fiscales, directement liée à une baisse de l’inflation plus forte qu’anticipée.
Autrement dit, les cordons de la bourse sont tenus, mais les revenus sont trop dépendants d’aléas conjoncturels. Ainsi, les recettes des prélèvements obligatoires accusent une moins-value de 21 milliards d’euros par rapport aux prévisions.
Monsieur le ministre, l’objectif reste le même : le retour à un déficit budgétaire sous la barre des 3 % du PIB à l’horizon de 2027. Cependant, la tâche s’annonce ardue et les équilibres à maintenir, fragiles.
Dès février, constatant la dégradation des comptes publics, vous avez annoncé 10 milliards d’euros d’économies dans le budget de cette année et 20 milliards d’euros pour l’année prochaine.
Le budget dédié aux outre-mer a été, comme les autres, mis à contribution à hauteur de 79 millions d’euros de crédits annulés. Pour autant, et je m’en félicite, il reste en forte hausse de 14 % sur un an avec 380 millions d’euros supplémentaires.
Ces économies sont nécessaires pour éviter un dérapage plus important et montreront à nos partenaires européens, à la Commission européenne, aux marchés financiers et aux grandes agences de notation notre volonté de responsabilité budgétaire.
Elles ne seront pourtant pas neutres économiquement : elles amputeront la croissance de 0,2 point de PIB en 2024, d’après l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), et de 0,6 point en 2025.
Ainsi, l’équilibre entre responsabilité budgétaire et soutien à la croissance sera au cœur de nos préoccupations dans les prochaines années. C’est pourquoi il me semble opportun d’œuvrer en parallèle, comme vous l’avez annoncé, à recouvrer les recettes fiscales escomptées initialement.
Par exemple, la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité, prévue pour rapporter 3 milliards d’euros en 2023, n’en a finalement rapporté que 300 millions. Monsieur le ministre, vous vous êtes exprimé sur le sujet et avez affirmé que le Gouvernement était prêt à améliorer le dispositif pour le rendre plus efficace dès cette année, à la hauteur des attentes. C’est une bonne chose.
La hausse des prix de l’énergie ces deux dernières années, notamment de l’électricité, a fortement contribué à la dégradation de l’économie ; elle a eu un impact sur le pouvoir d’achat de nos compatriotes, sur la compétitivité de nos entreprises et, in fine, sur le budget de l’État, en raison du coût des mécanismes de compensation et d’amortissement mis en place pour protéger les Français et les entreprises. Il est donc juste que ceux qui ont bénéficié de marges excessives au moment où les prix atteignaient des sommets participent au financement de ces compensations.
Par ailleurs, la réforme du marché européen de l’électricité, en cours d’adoption, sans découpler complètement les prix de l’électricité et du gaz, devrait nous permettre de ne plus revivre à l’avenir ce genre de situation.
Plus généralement, une meilleure évaluation de la dépense fiscale pourrait offrir des marges de manœuvre. Les outre-mer ont déjà fait cet effort dans la loi de finances pour 2024 : certains dispositifs de défiscalisation les concernant ont été réévalués pour en améliorer l’efficacité et en diminuer les effets d’aubaine.
Les revues de dépenses publiques prévues par la loi de finances pour 2024 devraient nous permettre d’effectuer une large remise à plat des dépenses budgétaires et fiscales de l’État. Les documents budgétaires affichent à ce titre une grande ambition, puisque ces procédures devraient permettre de dégager 6 milliards d’euros d’économies annuelles à partir de 2025.
Un mot sur la dette. Si l’objectif de déficit à moins de 3 % est maintenu pour 2027, il n’en va pas de même en ce qui la concerne, puisque ce programme de stabilité prévoit une dégradation de l’objectif à 112 % au lieu de 108,1 %.
Il s’agit évidemment d’une mauvaise nouvelle, mais celle-ci doit s’apprécier au regard de notre situation et de cette ambition tout à la fois d’assainissement et de soutien aux investissements stratégiques, qui s’inscrit dans la logique des nouvelles règles budgétaires européennes, car notre économie peut supporter ce niveau de dette. D’ailleurs, nous pouvons constater que les agences de notation n’ont pas abaissé la note de la France.
Les négociations à venir avec la Commission européenne et leurs conséquences posent plus de questions. Une procédure pour déficit excessif sera-t-elle ouverte ? Nous pouvons regretter que la réforme des règles budgétaires de l’Union européenne adoptée en début d’année ne permette pas de sortir les investissements pour la transition écologique du calcul de la dette. Certains pays, comme l’Allemagne, placent ces budgets dans des fonds spéciaux non comptabilisés dans leur dette. À la fin de 2022, ceux-ci recelaient 522 milliards d’euros de dette publique, selon la Cour des comptes allemande.
La priorité doit aller à la croissance, à l’emploi et au pouvoir d’achat. C’est notamment ce qui a justifié la politique du « quoi qu’il en coûte » ou la mise en place du bouclier tarifaire énergétique.
En la matière, la politique du Gouvernement est une réussite : le taux de chômage est au plus bas et le taux d’emploi n’a jamais été aussi élevé. Le signe le plus évident de cette situation est la disparition du chômage des principales préoccupations des Français.
La politique conduite depuis 2017 porte ainsi ses fruits. La France est devenue la nation la plus attractive d’Europe pour les investissements étrangers, elle connaît une croissance positive, hors le trou d’air de 2021. Les créations d’entreprises sont au plus haut – 400 000 par an – et nous avons créé 2 millions d’emplois, dont 100 000 emplois industriels. Nous assistons au retour de l’industrie dans le paysage économique français, avec six cents usines ouvertes.
Il ne faudrait pas qu’une politique budgétaire et fiscale trop restrictive vienne compromettre ces bons résultats. C’est en cela que la trajectoire présentée dans ce programme de stabilité est cohérente et réaliste. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Florence Blatrix Contat. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le programme de stabilité budgétaire que nous examinons aujourd’hui intervient tout juste un mois après l’annonce du dérapage inédit du déficit public pour l’année 2023.
Comme cela a été abondamment évoqué lors des interventions précédentes, ce programme a fait l’objet de vives critiques de la part du Haut Conseil des finances publiques.
Non seulement la trajectoire budgétaire prévue n’est pas considérée comme crédible à court terme, mais elle s’avère surtout non soutenable à moyen terme et elle ne permettra pas de mobiliser les financements indispensables pour répondre aux enjeux de notre pays : la transition écologique et la réindustrialisation.
En réalité, monsieur le ministre, tant que vous persisterez dans cette politique de désarmement fiscal, votre trajectoire budgétaire ne sera qu’un mirage qui abîmera encore davantage l’état de nos finances publiques.
Il semble que vous n’avez toujours pas tiré les leçons de vos erreurs passées, alors que vos choix politiques sont responsables des déséquilibres actuels et des pertes de recettes : suppressions de l’ISF, de la taxe d’habitation et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), baisse de l’impôt sur les sociétés…
Pourtant, vous persistez et vous signez : vous présentez une nouvelle trajectoire budgétaire envisagée sous le seul angle de la réduction des dépenses.
Que nous dit la littérature économique à ce sujet ? Que la réduction de la dépense publique peut avoir un effet récessif. Selon l’OFCE, l’annulation de 10 milliards d’euros de crédits budgétaires cette année retirerait 0,2 point de PIB. Les 20 milliards d’euros prévus pour l’an prochain pourraient, eux, impacter la croissance de 0,6 point.
Cela est d’autant plus préjudiciable que la bonne santé de nos recettes est étroitement liée à la croissance, socle fondamental du financement de notre modèle social.
La « voie française » que vous dessinez est une impasse. Écoutez donc les économistes, les institutions qui suggèrent d’explorer de nouvelles pistes, comme l’OFCE, qui recommande une augmentation de la fiscalité, en veillant bien sûr à ne pas alourdir le fardeau pour les classes moyennes et les plus modestes de nos concitoyens.
Comment ne pas être convaincu de cette nécessité, quand le taux effectif d’impôt sur le revenu des trente-sept ménages les plus aisés de France se limite à 0,26 % seulement, selon l’économiste Gabriel Zucman ?
L’évidence est de retrouver des marges fiscales, de réintroduire un impôt sur la fortune, d’instaurer une taxe sur les rachats d’actions. Il est indispensable de mettre en place une véritable taxe sur les superprofits et de rééquilibrer enfin la fiscalité entre travail et capital.
En ce qui concerne les dépenses, vous avez l’embarras du choix. Nous vous présentons quelques pistes : réduire les dépenses considérées comme antiécologiques, supprimer certains allégements fiscaux ou encore reconsidérer des décisions politiques inutiles – je pense en particulier au service national universel (SNU) ou à l’uniforme en classe.
Que faites-vous en réalité ? Vous choisissez de vous en prendre à la sphère sociale et, encore une fois, aux collectivités territoriales.
Des solutions existent, mais, comme d’habitude, vous décidez seul et vous méprisez le Parlement. À cet égard, le Gouvernement n’a toujours pas répondu à la demande du groupe socialiste d’un débat, au titre de l’article 50-1 de la Constitution, portant sur un budget pour protéger les Français et préparer l’avenir.
Comme d’habitude, les premières victimes de vos politiques budgétaires seront la transition écologique et les classes moyennes et, comme d’habitude, vous contribuerez à nourrir la défiance des Français à l’égard de l’impôt, avec les risques démocratiques que cela comporte.
Ce programme de stabilité porte en lui, en réalité, tous les risques : déstabilisation de l’économie, injustice sociale et renoncement aux ambitions environnementales. Il nous conduira certainement à de l’injustice sociale supplémentaire, sans doute à de l’instabilité budgétaire, et il ne nous empêchera pas d’être le cancre de la zone euro. (Applaudissements sur les travées du groupe SER et sur des travées des groupes CRCE-K et GEST.)
M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey. (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains. – M. le rapporteur général de la commission des finances applaudit également.)
M. Hervé Maurey. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes amenés aujourd’hui à examiner le programme de stabilité et d’orientation des finances publiques des années 2024 à 2027 présenté par le Gouvernement. À l’examen de ce document, que constatons-nous ?
La trajectoire est étonnamment différente de celle qu’a présentée le Gouvernement, par la voix du même ministre, dans la loi de programmation des finances publiques promulguée il y a à peine quatre mois.
La trajectoire de croissance est revue fortement à la baisse ; la prévision du déficit public est portée à 5,1 % du PIB en 2024, soit une augmentation de plus de 20 milliards d’euros par rapport à celle qui prévalait il y a seulement quatre mois.
Comment ne pas s’étonner d’un tel réajustement ? Comment ne pas mettre en doute la crédibilité des prévisions du Gouvernement, voire leur sincérité, dès lors que celui-ci semble avoir été informé dès le 7 décembre dernier que le déficit public pourrait s’élever à 5,2 % et non plus à 4,9 % ?
Si la trajectoire est revue, les conjoncturistes ne partagent pas davantage ce scénario que les précédents.
Ainsi, le Haut Conseil des finances publiques considère que la trajectoire retenue pour le PIB potentiel est surévaluée. Il y a donc, selon lui, « un risque important que l’évaluation soit révisée nettement plus à la baisse et donc que la part structurelle du déficit soit à la hausse ». Il estime par ailleurs que la France restera parmi les trois pays les plus endettés de la zone euro.
L’ensemble de la stratégie d’amélioration des comptes publics défendue par le Gouvernement repose donc sur des hypothèses qui ne sont ni documentées ni partagées par la vingtaine d’instituts composant le Consensus Forecast.
Le maintien d’un objectif de retour – même de justesse – du déficit sous la barre des 3 % en 2027 relève – vous le savez, monsieur le ministre – de l’incantation, de la communication et de la méthode Coué.
Le Haut Conseil considère, en effet, que l’atteinte de cet objectif « manque de crédibilité », car elle « supposerait un ajustement structurel massif » qui nécessiterait « un effort d’économies » qui n’a « jamais été réalisé par le passé » et « la mise en place d’une gouvernance rigoureuse », condition « qui n’est pas réunie aujourd’hui ». Je crois que tout est dit !
Pour tout vous dire, messieurs les ministres, je suis certain que vous-même ne croyez pas un instant à l’atteinte de cet objectif et je suis prêt à parier aujourd’hui qu’il ne sera pas tenu.
Monsieur le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, comme vous l’a rappelé le Président de la République, vous avez la charge de nos finances depuis maintenant sept ans. Pourquoi nous alimenter en permanence de prévisions qui ont prouvé qu’elles n’étaient pas crédibles ?
Pourquoi avoir fait adopter une loi de programmation des finances publiques et un budget dont nous avions souligné l’absence de crédibilité ?
Pourquoi avoir refusé les économies – 7 milliards d’euros ! – et les recettes supplémentaires proposées par le Sénat ?
Pourquoi, malgré la situation, le Gouvernement continue-t-il chaque semaine d’annoncer des mesures qui aggravent notre déficit public ?
Pourquoi continuer à vouloir réduire les recettes de l’État ? Tout récemment encore, le Premier ministre a confirmé qu’une baisse d’impôts de 2 milliards d’euros serait appliquée en 2025 pour les ménages. Pour mémoire, la suppression de la taxe d’habitation, celle de la contribution à l’audiovisuel public et la baisse de la CVAE coûtent déjà 35 milliards d’euros par an à l’État.
Pourquoi ne jamais reconnaître vos erreurs ?
Pourquoi ne pas vous attaquer réellement à la baisse des dépenses publiques ?
Pourquoi faire semblant de croire qu’il s’agit d’un simple problème de recettes qui seraient conjoncturellement moins importantes que prévu ?
Pourquoi vouloir faire peser sur les collectivités locales une partie des conséquences de cette situation, alors que celles-ci n’en sont absolument pas responsables ?
Pourquoi refuser que le Parlement soit saisi de ces questions essentielles ?
Voilà, messieurs les ministres, quelques interrogations sur lesquelles nous aimerions obtenir des réponses ! (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains. – M. le rapporteur général de la commission des finances applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie tout d’abord de la qualité de ce débat sur le programme de stabilité et notre trajectoire financière jusqu’en 2027.
Je commencerai par répondre au rapporteur général de la commission des finances sur les performances économiques 2017-2024. Je ne suis pas spécialement optimiste, j’essaie seulement d’être réaliste et de rendre à la France et aux Français ce qui leur appartient : leur résultat économique.
Il se trouve que la croissance cumulée de la France sur la période 2017-2023 est la plus forte parmi toutes les grandes nations européennes : la croissance cumulée de l’Allemagne de 2017 à 2023 est de 3,7 %, celle du Royaume-Uni de 5,6 %, celle de l’Italie de 5,8 % et celle de la France de 6,9 % – près de 7 %.
Ce n’est pas un hasard si la France est devenue en quelques années, depuis la mise en place de la politique économique menée sur l’initiative du Président de la République, la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe. (M. Alain Duffourg marque sa désapprobation.) C’est la première fois que cela se produit, ce qui est la preuve de l’efficacité de notre politique économique, qui apparaît également dans les chiffres de croissance.
Vous évoquez certains conjoncturistes. Vous avez beau jeu de taxer le Gouvernement d’insincérité, alors même qu’il tient ses prévisions de croissance, mais il convient peut-être de s’intéresser à ce qui se passe de leur côté !
L’un d’entre eux, connu et respecté, qui fait référence, ne cesse de proclamer depuis des semaines et des semaines que la France fera 0,5 % de croissance en 2024. Il l’assène sur tous les plateaux, dans tous les journaux, sur tous les canaux de télévision.
Or nous avons fait 0,2 % au premier trimestre, nous avons donc déjà 0,5 % d’acquis de croissance pour 2024. Ainsi, s’il a raison, nous ferons 0 % de croissance au deuxième, au troisième et au quatrième trimestre, ce qui n’est ni souhaitable ni plausible.
C’est pourquoi je souhaite que nous élargissions notre regard aux fausses prévisions réalisées par certains experts. C’est d’ailleurs le même prévisionniste qui avait prévu avec beaucoup d’assurance et de détermination une récession pour 2023. Il était entendu que la France passerait par cette case : nous avons fait 0,9 % de croissance – pas très loin des 1 % prévus par le Gouvernement.
Je ne dis pas tout cela pour le Gouvernement, mais pour les Français qui travaillent, pour les entrepreneurs, pour les PME, pour les industriels. Cessons de dévaloriser systématiquement les capacités économiques de notre pays qui, dans un environnement difficile, est l’un de ceux qui ont le mieux résisté économiquement et qui continue à apporter la preuve de son efficacité et de son volontarisme !
Le vrai sujet – vous l’avez évoqué, monsieur le rapporteur général – est la productivité européenne. Je vous rejoins totalement sur la nécessité d’un débat sur ce thème.
Notre problème n’est pas la croissance française : celle-ci se tient, elle est solide, grâce à l’activité de nos entreprises, mais bien la croissance européenne, qui est un point ou un point et demi derrière celle des États-Unis, parce que, depuis des années, l’Union européenne, au lieu de se consacrer à l’innovation et à la recherche, au lieu de prendre des risques, multiplie les normes, les règles et la complexité administrative.
Il faut libérer la croissance européenne ; c’est ce que nous essayons de faire avec le Président de la République. Là est le vrai débat ; là est le vrai enjeu.
Monsieur Raynal, je partage ce que vous avez dit sur les recettes, notamment sur la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité. Et je suis, comme toujours, sincère et honnête : nous avions envisagé 3 milliards d’euros de recettes issues de cette contribution, notamment de la part des énergéticiens, nous en avons obtenu 300 millions, c’est un échec. Nous ne pouvons pas en rester là, il nous faut corriger ce dispositif et nous le ferons pour obtenir les recettes attendues.
Madame Doineau, j’ai eu l’occasion de m’exprimer sur les économies et la croissance. Contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, il ne me semble absolument pas qu’augmenter toujours plus la dépense publique, les déficits et la dette soit bon pour la croissance. Je tiens au contraire que des comptes bien tenus sont le gage d’une croissance solide : cela restaure la confiance des entreprises et des ménages, qui, dès lors, libèrent leur épargne et investissent au lieu de garder de l’argent de côté.
Monsieur Cozic, vous nous accablez sur le mur de la dette, mais vous ne me semblez pas proposer quoi que ce soit pour le faire tomber, sinon des dépenses nouvelles et de nouveaux impôts. Notre stratégie est différente : nous refusons les augmentations d’impôt et nous croyons à la croissance, aux réformes et aux réductions de dépenses.
Monsieur le président Retailleau, vous avez eu des mots durs pour le Gouvernement : nous ne manquerions pas d’air, nos choix seraient irresponsables, il y aurait un décrochage, des mensonges… Vous n’y êtes pas allé avec le dos de la cuiller, mais, au fond – c’est en tout cas ainsi que je le comprends –, qui aime bien châtie bien ! (Sourires.)
Je voudrais simplement, en réponse, faire un peu d’histoire sur le niveau de la dette française. Bien entendu, celle-ci est trop élevée ; c’est vrai, mais cela remonte à quelques années, pour ne pas dire à quelques décennies.
Le premier décrochage a eu lieu pendant la crise financière de 2008-2010, avec vingt-six points de dette supplémentaires. Cependant, tandis que, au lendemain de la crise financière, tous nos partenaires européens ont cherché à retrouver leur niveau d’endettement antérieur, la France a poursuivi dans la même direction, si bien que, lorsque nous sommes arrivés aux affaires en 2017, la dette française approchait déjà les 100 % du PIB – 97,5 %, pour être exact.
Ensuite est venue une nouvelle crise, celle du covid-19, pendant laquelle, en effet, nous avons consenti quinze points de dette supplémentaires, dans la moyenne haute des pays européens ; je le reconnais volontiers, car, en dépensant plus, nous avons mieux protégé.
C’est dans ce contexte que se noue l’enjeu, essentiel, de notre débat, car c’est maintenant que tout se joue : soit la France retombe dans ses vieux travers, en considérant que les dépenses exceptionnelles deviennent des dépenses ordinaires, comme un acquis social, auquel cas on les perpétue, en continuant de laisser filer le déficit et la dette ; soit, au contraire, pour la première fois depuis trois décennies, nous rétablissons les comptes, en estimant que les dépenses exceptionnelles doivent le rester, qu’il faut réduire les dépenses et relancer la croissance pour reconstituer des réserves qui nous serviront en cas de nouvelle crise. Tel est le choix politique fondamental qui se joue maintenant ! Vous aurez compris que le nôtre est fait : c’est de rétablir les comptes publics.
Pour ce qui concerne ces quinze points de dette, oserai-je rappeler que vous avez, vous aussi, participé à ces dépenses de protection ? Je salue la sollicitude dont vous avez fait preuve pendant la crise du covid-19 à l’égard d’un certain nombre de professions ; vous m’avez ainsi écrit, à plusieurs reprises, pour me demander plus d’aides pour les masseurs-kinésithérapeutes, pour les commerces de gros, pour les entreprises de voyage, pour les discothèques, pour les entreprises industrielles de services textiles, et pour d’autres encore…