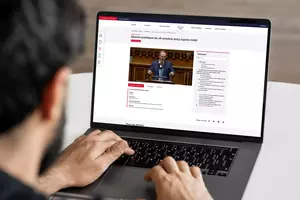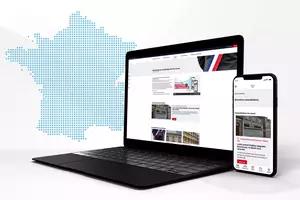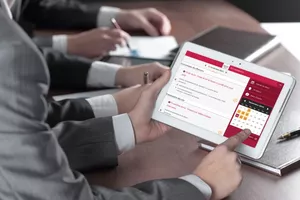E. LA MONDIALISATION EN TEMPS DE CRISE ET DE GUERRE : LE RÔLE DE L'OCDE DEPUIS L'AGRESSION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE CONTRE L'UKRAINE
1. L'intervention de M. Bertrand Bouyx, président de la commission des questions politiques et de la démocratie
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Secrétaire général,
Mesdames et Messieurs, mes chers collègues,
Il me revient aujourd'hui, en ma capacité de président de la commission des questions de politique et de la démocratie, de vous présenter le rapport préparé par notre ancien collègue M. George KATROUGALOS - qui n'est plus membre de cette Assemblée - sur les activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Notre débat aujourd'hui porte un caractère institutionnel. Les relations entre nos deux Organisations datent du début des années 1960 ; depuis 1993, l'Assemblée parlementaire élargie aux représentants des États membres de l'OCDE qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe constitue une plateforme unique pour procéder à un examen parlementaire des activités de l'OCDE.
À cette occasion, je me félicite de la présence parmi nous de M. Mathias CORMANN, Secrétaire général de l'OCDE depuis juin 2021.
Monsieur CORMANN, votre mandat à la tête de l'OCDE coïncide avec une période de fortes turbulences auxquelles l'économie mondiale fait face et qui constituent autant de défis pour nos États et pour nos Organisations.
J'espère, Monsieur le Secrétaire général, que face à ces défis vous continuerez les traditions de vos prédécesseurs, notamment de M. Angel Gurría qui tenait très à coeur le dialogue avec les membres de cette Assemblée sur les problèmes qui nous préoccupent toutes et tous.
Pour rendre ce dialogue plus substantiel, l'Assemblée de l'OCDE a conclu en 2019 un accord qui prévoit entre autres que le thème spécifique du débat sera dorénavant choisi de commun accord entre les deux parties.
Ainsi, notre ancien rapporteur a proposé, avec l'accord des collègues de l'OCDE, que le présent débat se concentre sur les conséquences pour l'économie globale des deux chocs majeurs et sans précédent : la pandémie du covid et l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, ceci dans un contexte qui était déjà caractérisé par des tendances négatives de ralentissement de l'économie mondiale - à tel point que certains parlent de « démondialisation ».
Bien évidemment, le rôle que l'OCDE peut jouer et joue déjà pour contrer ou au moins atténuer ces tendances négatives est l'élément clé de notre débat aujourd'hui. En effet, le rapport de notre ancien collègue, rédigé sur la base des contributions de plusieurs départements experts de l'OCDE, présente un paysage très détaillé de l'état de l'économie mondiale et constate un certain nombre de problèmes et tendances alarmantes au sein de nos pays et sociétés.
Mon temps de parole étant limité, je ne vais pas vous donner lecture du rapport mais je vous encourage toutes et tous à l'étudier : il est bien structuré, bien documenté, et ceci grâce à la recherche de nos collègues de l'OCDE. Je profite de cette occasion pour les en remercier.
Cependant, j'attire votre attention sur un certain nombre de défis identifiés dans le projet de résolution que la commission vous a présenté : selon l'OCDE, à la suite de la pandémie du covid-19, de la guerre d'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et de la crise consécutive de l'énergie et du coût de la vie, la plupart de nos pays ont été aux prises avec des déficits budgétaires, une dette publique élevée et des perspectives de croissance économique modestes. Les dépenses publiques ont grimpé et le taux d'endettement public a considérablement augmenté. Les tendances à moyen et long terme comme le vieillissement de la population et la hausse du prix relatif des services continueront à peser davantage sur les dépenses publiques consacrées aux retraites, à la santé publique et aux soins de longue durée.
Les effets conjugués de la pandémie de covid-19, des conflits mondiaux, de la crise climatique et des inégalités croissantes ont réduit à néant les progrès réalisés au niveau mondial en matière de réduction de la pauvreté. Le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, qui était en nette diminution depuis près de 25 ans, est aujourd'hui en augmentation.
Avec les perturbations des marchés des produits alimentaires et de l'énergie provoquées par la guerre d'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine en février 2022, l'inflation mondiale atteint des niveaux que de nombreux pays n'avaient pas connus depuis les années 70. Cette forte inflation a engendré un cri du coût de la vie, érodant le revenu disponible net des ménages et leur niveau de vie, tout en ralentissant la croissance et les dépenses de consommation. Ce sont les ménages à faibles revenus et les ménages ruraux qui sont généralement les plus durement touchés par la hausse des prix des produits alimentaires et d'énergie.
Nous sommes très inquiets, avec l'OCDE, des effets négatifs de la crise sur la confiance aux pouvoirs publics. Selon les études de l'OCDE, moins d'un tiers des personnes interrogées, tous pays confondus, estiment que le système politique de leur pays leur permet d'avoir voix au chapitre dans la prise de décisions publiques. Les jeunes, les personnes peu instruites et celles de faibles revenus accordent en moyenne moins leur confiance aux pouvoirs publics que ces autres groupes.
Ces tendances témoignent de la nécessité, pour les pays de l'OCDE, de consolider leur système de gouvernance démocratique en renforçant la participation des citoyens au processus politique et en luttant contre la propagation des informations fausses et trompeuses qui peuvent décourager la participation démocratique, fausser des débats politiques et affaiblir la résilience de la société.
Dans cette optique, on se félicite de la Déclaration de l'OCDE sur l'instauration de la confiance et le renforcement de la démocratie adoptée par les ministres en novembre 2022, qui inclut des engagements et des mesures pour renforcer confiance et démocratie.
La crise multiforme risque d'affecter nos ambitions en matière de politique visant à stopper le changement climatique. Pour pouvoir atténuer véritablement ce changement climatique, il faudra procéder à une transformation en profondeur, massive, rapide de nos économies et de nos approvisionnements énergétiques. Des mesures fortes de réduction des émissions, des progrès technologiques et des investissements à grande échelle seront cruciaux.
Dans ce contexte, notre coopération avec les institutions telles que l'OCDE devient encore plus importante. Il est essentiel que la communauté des pays membres de l'OCDE demeure attachée, comme réaffirmé dans les conclusions politiques du Conseil au niveau des ministres de 2023, aux valeurs communes que sont les libertés individuelles, la démocratie, l'État de droit, la protection des droits humains, l'égalité des genres, la durabilité de l'environnement et la lutte contre les inégalités ainsi que la diversité et l'inclusion.
Il est également essentiel que les pays membres de l'OCDE réaffirment l'importance du multilatéralisme et de l'unité pour relever les défis mondiaux ainsi que la volonté d'aller au-delà des États membres actuels pour renforcer et développer les partenariats mondiaux.
Des politiques globales tenant compte non seulement des enjeux fiscaux économiques mais aussi de tous les éléments de la réalité économique dans différents pays, y compris des défis environnementaux, les politiques sociales et l'emploi, sont la clé d'une réponse efficace à la crise multiforme que nous traversons et doivent ainsi s'attacher à ne pas laisser des personnes de côté.
Le projet de résolution que la commission vous a présenté contient également les propositions pour modifier le Règlement relatif aux débats élargis sur les activités de l'OCDE afin de tenir compte de l'élargissement de cette organisation, notamment du fait de l'adhésion de deux pays de l'Amérique latine : la Colombie et le Costa Rica.
Par la même occasion, nous exprimons notre conviction que le plein respect de la démocratie, des droits humains et de l'État de droit, y compris le droit international, constitue un critère essentiel dans le processus d'élargissement de l'OCDE.
Dans ce contexte, nous salons l'adoption par l'OCDE des feuilles de route pour l'adhésion des trois pays membres du Conseil de l'Europe, à savoir la Bulgarie, la Croatie, et la Roumanie, ainsi que du Brésil et du Pérou.
Avant de terminer, je salue l'avis présenté par la commission des questions sociales, de la santé du développement durable, ainsi que les propositions d'amendements que cet avis contient : notre commission les a trouvés positifs, utiles et s'est prononcée en faveur de les inclure dans notre texte de la résolution.
Monsieur le Président, je m'arrête là et j'espère que le rapport de notre commission fourni aux membres de l'Assemblée a suffisamment d'éléments pour un débat renseigné et stimulant.
Merci à toutes et tous pour votre attention.
Monsieur le Président.
2. L'intervention de Mme Liliana Tanguy, rapporteure pour avis au nom de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable
Merci, Monsieur le Président.
Chers collègues,
Je tiens à féliciter M. George KATROUGALOS pour son rapport particulièrement éclairant, lequel souligne à juste titre le rôle significatif joué par l'OCDE pour lutter contre les effets dévastateurs d'une série de crises qui, s'imbriquant les unes aux autres, ont ébranlé l'ordre établi.
Celles-ci ont pour conséquence de remettre en question l'orientation des politiques actuellement en place et encouragent la réflexion sur ce que les autorités nationales et les organisations internationales pourraient faire pour résoudre les problèmes systémiques actuels et futurs.
Je partage aussi l'analyse faite par le rapporteur sur la base des réflexions et des recommandations de l'OCDE, qui insiste sur la nécessité de mener des politiques plus transversales et globales. C'est la raison pour laquelle il convient de louer toute initiative visant à renforcer la coopération entre l'OCDE et le Conseil de l'Europe, qui sont des institutions essentielles pour lutter contre l'accroissement des inégalités.
Le rapport met bien en perspective l'influence du contexte mondial sur le commerce international et la croissance économique. La commission des questions sociales s'est néanmoins montrée très préoccupée par le fait que les tensions géopolitiques, la pandémie, la crise climatique et l'augmentation des inégalités aient inversé les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable et relégué les droits socio-économiques au second plan.
Une croissance économique effrénée risque de compromettre non seulement la durabilité environnementale sociale du système mondial, mais aussi, à terme, la résilience économique et la confiance du public dans la démocratie. Nous devons donc plaider pour un équilibre plus juste dans les intérêts publics et privés.
Je souhaite revenir, avec une remarque plus personnelle, sur la question de l'intelligence artificielle. Je regrette qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un développement plus poussé dans les travaux menés par la direction de la commission des questions politiques. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos quotidiens et c'est la raison pour laquelle la commission des questions sociales a proposé un amendement en ce sens.
Je voudrais ici rappeler que l'OCDE contribue d'ailleurs à y répondre en hébergeant le secrétariat dédié aux activités et à la gouvernance du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, qui a été proposé par la France et le Canada lors du G7 de Biarritz.
Il faut aussi noter le rôle de l'OCDE dans la lutte contre la pauvreté et le changement climatique, avec l'accueil dans les prochaines semaines du secrétariat du Pacte de Paris pour les peuples et la planète qui a été initié dans le cadre du Sommet de Paris en juin dernier : car, rappelons-le, les pays en développement ne doivent pas choisir entre lutter contre la pauvreté et protéger l'environnement.
La crise énergétique, le ralentissement de l'économie mondiale et la paupérisation généralisée fragilisent notre modèle démocratique et sapent la confiance des citoyens dans la compétence et les valeurs de nos institutions publiques. Ces crises interrogent la vulnérabilité et la résilience de nos sociétés.
Je pense que, dans ce contexte, les États doivent être garants d'une démocratie qui fonctionne bien, donner à la société civile des droits à la liberté et entourer les entreprises de réglementations claires : c'est la base des droits de l'homme et d'un monde plus vert, plus résilient et plus juste.
Je vous remercie.
3. L'intervention de M. Christophe Chaillou
Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire général de l'OCDE,
Mes chers collègues,
Permettez-moi tout d'abord de vous dire le plaisir qui est le mien de m'adresser à vous en tant que nouveau membre de cette Assemblée, et ce depuis mon élection à l'automne dernier au Sénat de la République française.
Je voudrais féliciter M. George Katrougalos et ma collègue Liliana Tanguy pour le rapport qui nous est soumis au débat et qui met l'accent sur le rôle que peut jouer le multilatéralisme pour lutter contre les chocs économiques provoqués par les crises internationales, comme celles - cela a été dit - de la pandémie ou de l'agression russe contre l'Ukraine.
Ces deux crises se sont notamment traduites par une forte inflation, certains d'entre vous l'ont dit, dans les secteurs de l'alimentation et de l'énergie en particulier.
Elles ont également mis en valeur les dépendances commerciales auxquelles nous expose la mondialisation ainsi que les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Ce sujet est d'autant plus important que les tensions géopolitiques s'accentuent, soulevant d'intenses débats politiques dans nos États sur la résilience de nos économies et sur un éventuel ralentissement de la mondialisation.
C'est ainsi qu'au Parlement français, nous avons eu des débats très vifs sur certains accords commerciaux internationaux signés par la Commission européenne, perçus par nombre d'élus nationaux locaux et de citoyens comme étant foncièrement négatifs pour la souveraineté agricole de l'Europe. Les manifestations qui sont en cours en ce moment depuis quelques jours dans mon pays, en France, mais aussi dans d'autres pays européens, soulignent parfois dramatiquement la façon dont sont perçus ces accords sur le terrain.
Ces débats sont donc importants. Ils nous renvoient à notre propre cohérence interne et au respect des valeurs que nous défendons, notamment les valeurs fondamentales auxquelles nous sommes particulièrement attachés : les droits humains, l'État de droit, la promotion du développement durable. Il convient à cet égard de saluer l'accent mis désormais par l'Union européenne, dans ses négociations commerciales, sur les chapitres relatifs au commerce et au développement durable, sur la lutte contre la déforestation, sur la lutte contre le changement climatique et sur le respect des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail.
L'OCDE joue un rôle essentiel pour promouvoir des échanges libres et équitables ainsi que la résilience des chaînes d'approvisionnement. Je me félicite donc du dialogue institutionnel qui peut exister entre cette organisation et notre Assemblée pour accentuer la prise en compte des valeurs humanistes qui fondent notre appartenance commune au Conseil de l'Europe, ainsi que l'enjeu de l'adaptation des politiques sociales mises en place par nos États pour faire face à la recrudescence de la pauvreté et à ses effets.
Ce rapport, et je voudrais terminer par cela, souligne en effet que l'extrême pauvreté, qui était en net recul depuis plus de 25 ans, est aujourd'hui repartie à la hausse. Cette tendance, que nous constatons dans de nombreux pays, y compris le mien, est bien évidemment inquiétante et nécessite la prise de mesures sociales, budgétaires et fiscales répondant aux attentes des concitoyens. L'OCDE, par la qualité des initiatives et des analyses qu'elle produit, peut être un outil précieux pour les calibrer au mieux.
Je vous remercie pour votre attention.
4. L'intervention de Mme Marietta Karamanli
Ce projet de rapport a le mérite d'instiller une dose d'espoir dans un contexte de tensions internationales alors même que de nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux se posent aux États et que nous cherchons les moyens de mobiliser des ressources pertinentes et suffisantes pour y parvenir.
Le rapporteur examine les diverses initiatives politiques proposées par l'OCDE pour atténuer les tendances négatives d'économies mobilisées pour partie par la guerre. Il évoque notamment celui de la taxation des grandes entreprises transnationales.
Comme le dit l'économiste Gabriel Zucman, avec qui je travaille, en 2021, il y a eu beaucoup d'espoir quand 140 pays se sont mis d'accord à l'initiative de l'OCDE sur le principe d'une taxe minimale à 15 % sur les bénéfices des sociétés multinationales.
C'était vraiment un grand progrès, même si le taux proposé était nettement plus faible que ce que doivent payer les petites et moyennes entreprises dans beaucoup de pays, parce que c'était la première fois qu'il y avait un accord international qui venait fixer un taux minimum d'imposition.
Le projet semble déjà rongé par des niches ou pratiques.
Aucune grande entreprise au monde ne devrait échapper à une taxation minimale capable de financer une partie des besoins notamment eu égard à l'urgence et à l'importance de la transition énergétique et environnementale.
Je note que les seuls États européens pourraient voir leurs recettes augmenter de 170 milliards d'euros par an en cas d'instauration d'une taxe mondiale à 25 % sur les bénéfices des multinationales.
Je pense que l'ensemble des États et l'OCDE devrait d'ores et déjà se mobiliser pour examiner une taxation des hyper-riches...
Le taux effectif d'imposition des quelque 3 000 milliardaires dans le monde est très faible : entre zéro et 0,5 % de leur fortune.
Ils évitent la taxation effective par des sociétés personnelles de détention de patrimoine ou la possession d'actions et obligations lui échappant.
La mise en place d'un impôt minimum mondial de 2 % sur le patrimoine de 2 800 milliardaires pourrait potentiellement générer 214 milliards de dollars de revenus, équivalant à 202 milliards d'euros.
De quoi financer une partie de la transition écologique en s'appuyant sur la réduction des inégalités de fortune !
5. L'intervention de M. Claude Kern
Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire général de l'OCDE,
Mes chers collègues,
Les rencontres régulières que nous avons avec l'OCDE constituent un moment important pour notre Assemblée, qui s'élargit pour l'occasion à des représentants d'États membres de l'OCDE n'appartenant pas au Conseil de l'Europe, ainsi qu'à une délégation du Parlement européen.
Après le thème de la lutte contre l'injustice fiscale et de l'imposition de l'économie numérique, cette rencontre nous permet d'aborder les effets économiques et sociaux des chocs provoqués par la pandémie de covid-19 et la guerre d'agression contre l'Ukraine.
Je souhaite évoquer plus particulièrement la très forte hausse des prix de l'énergie constatée après le début de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a utilisé contre l'Europe l'arme de l'énergie. L'Europe était dépendante de la Russie pour son approvisionnement en gaz, certains États membres plus que d'autres. La prise de conscience de cette dépendance a été lente et à bien des égards trop tardive. Modifier la trajectoire énergétique d'un pays prend du temps. Nous avons bien oeuvré pour diversifier nos approvisionnements mais au-delà de cette première phase, la transition énergétique, qui rejoint l'objectif de lutte contre le changement climatique, doit nous permettre de réduire encore cette dépendance.
Je veux toutefois mettre en garde contre les conséquences sociales de cette transition, qui a un coût important pour les entreprises et pour les ménages. Il faut absolument prévoir des mesures d'accompagnement et je crois que l'OCDE peut jouer un rôle important pour nous aider à bien les calibrer.
Le Sénat français a appelé à plusieurs reprises l'attention sur l'impact social de la transition verte décidée par l'Union européenne dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe. Les revendications des syndicats agricoles que l'observe aujourd'hui dans plusieurs États européens, et notamment en France, nous montrent que de belles idées sur le papier peuvent avoir des conséquences politiques très fortes si elles sont mal accompagnées ou mal articulées avec d'autres politiques.
Une politique ambitieuse et « vertueuse » qui donne à des franges entières de la population un sentiment de déclassement ou qui les plonge dans de grandes difficultés économiques ne sont tout simplement pas soutenables.
Elles ne sont pas soutenables pour la cohésion de nos sociétés. Elles ne seront donc pas soutenables sur le plan politique et je pense que nous devons bien avoir ce point présent à l'esprit alors que se profilent les élections européennes dans plusieurs de nos États membres.
6. L'intervention de M. François Bonneau
Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire général de l'OCDE,
Mes chers collègues,
Je remercie nos collègues George Katrougalos et Liliana Tanguy pour leurs rapports et je me réjouis que nous puissions débattre au sein de notre Assemblée des activités de l'OCDE.
Le thème retenu cette année m'apparaît particulièrement important. En effet, la pandémie de covid-19 puis la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine ont mis à nu un certain nombre de fragilités de l'Europe, notamment sur le plan des chaînes d'approvisionnement et de l'énergie.
La mondialisation peut être heureuse, et nous souhaitons naturellement tous qu'elle le soit. Mais les tensions géopolitiques que nous constatons partout dans le monde doivent nous conduire à être moins naïfs et plus réactifs.
Les conséquences économiques parfois très brutales qui en découlent interrogent nos modèles économiques et nos valeurs.
L'inflation alimente le sentiment de relégation des populations les plus fragiles et peut mettre à mal la cohésion de nos sociétés. À rebours des objectifs de développement durable de l'ONU, la montée de la pauvreté dans le monde génère des flux migratoires qui peuvent également mettre nos sociétés sous tension. Nous en avons débattu hier soir.
Il m'apparaît donc essentiel de prévoir des politiques budgétaires, fiscales et sociales adaptées pour faire face aux chocs externes et maintenir la cohésion de nos sociétés. Sans cela, la sanction politique risque d'être lourde.
Le rapport de notre collègue George Katrougalos souligne à cet égard que moins d'un tiers des personnes interrogées, tous pays confondus, considèrent que le système politique de leur pays leur permet d'avoir voix au chapitre dans la prise de décisions publiques. La même proportion pense que les pouvoirs publics tiendraient compte des avis exprimés lors d'une consultation de la population.
Les jeunes, les personnes peu instruites et celles ayant des revenus faibles accordent en moyenne un niveau de confiance plus faible aux pouvoirs publics.
L'évaluation des politiques publiques menées et la capacité à les ajuster pour réduire les tensions sociales sont donc essentiels pour conforter nos systèmes de gouvernance démocratique.
Je remercie également notre collègue de souligner, dans ce contexte, la menace que constitue la propagation de fausses informations, notamment à l'initiative d'États qui nous sont hostiles. Là encore, les pouvoirs publics doivent se montrer mieux armés et plus réactifs pour contrer la diffusion d'informations fallacieuses qui sapent la confiance dans nos institutions.
Je vous remercie.