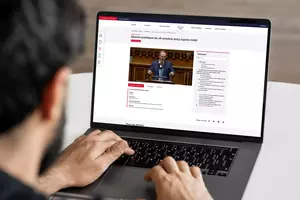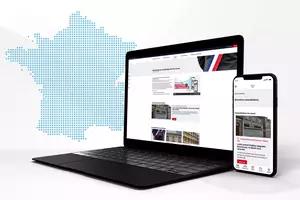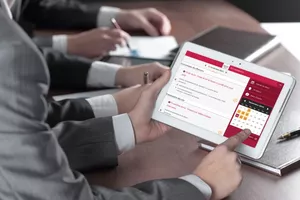Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 04/04/2024
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie sur la nécessité de développer une stratégie française en matière d'intelligence artificielle compatible avec le principe de sobriété énergétique et de frugalité dans la consommation de matières premières.
Alors que le Parlement européen a récemment adopté l'« AI Act » qui vise à réguler la recherche et le développement de technologies d'intelligence artificielle - notamment l'intelligence artificielle (IA) générative - pour prévenir une menace évidente pour la sécurité, les moyens de subsistance et les droits des personnes, de nombreux acteurs soulignent que ce règlement européen n'encadre pas la dimension environnementale de cette technologie. En effet, il n'existe pas de réglementation de la consommation énergétique et hydrique des infrastructures sur lesquelles reposent les technologies d'intelligence artificielle.
Or, le rapport de Cédric Villani du 28 mars 2018 a souligné les nombreuses limites climatiques et de disponibilité des ressources du développement de l'intelligence artificielle. Cela a notamment incité le Gouvernement à inclure la mise de l'IA au service de la transition écologique au sein de la stratégie nationale pour l'IA. Toutefois, cette priorité semble entrer en conflit avec d'autres priorités de cette même stratégie telles que le développement de l'IA générative et de modèles géants de langage.
Selon plusieurs acteurs du secteur numérique, l'entraînement des modèles de langage existants et en cours de développement consommerait autant d'énergie que ne le font annuellement des milliers de foyers américains. À titre d'exemple, un grand groupe américain spécialiste des moteurs de recherche estime qu'une question posée à une IA générative consomme dix fois plus d'énergie qu'une recherche effectuée sur un moteur de recherche.
Par ailleurs, la quantité d'eau requise pour le refroidissement des serveurs et la production d'électricité nécessaire au fonctionnement des modèles géants de langage, estimée à plusieurs centaines de milliers de litres annuels, serait aussi notable.
Enfin, en matière de consommation de matières premières et de produits semi-finis, le rapport Villani de 2018 a bien souligné l'enjeu de la disponibilité à moyen et long-terme des semi-conducteurs nécessaires à la fabrication des supercalculateurs sur lesquels repose l'IA au regard des réserves mondiales, notamment de silicium, à horizon 2040.
Face aux nombreux conflits d'usages liés aux ressources exploitées par l'IA entre les différents secteurs industriels et même le monde agricole qui pourraient se manifester dans les années à venir, il convient de préciser les conditions dans lesquelles le développement de l'intelligence artificielle sera effectivement bénéfique à notre économie et compatible avec la transition écologique.
Il souhaite donc connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement afin de garantir que le développement de l'intelligence artificielle en France et en Europe ne se fasse pas au détriment de la transition écologique.
- page 1381
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie publiée le 30/05/2024
L'intelligence artificielle (IA) est un outil de choix pour répondre à certains défis de la transition écologique, notamment dans les secteurs du transport, de l'aménagement, de la gestion des risques, de l'énergie et de la gestion de l'eau. Elle constitue une opportunité, dont se sont saisis les ministères, pour répondre à des enjeux prioritaires de réduction de consommation de nos ressources, de connaissance des dynamiques du territoire et de mise en oeuvre des politiques publiques environnementales. L'impact environnemental des modèles d'IA est un critère déterminant de l'évaluation en opportunité d'une solution d'IA, car les limites physiques (métaux, eau, gaz à effet de serre) présentent en effet un risque majeur pour le développement de l'IA. La frugalité est aussi un enjeu de souveraineté (accès aux ressources) et de compétitivité (demande forte pour des solutions vertes), qui doit donc être un axe de notre action au niveau européen et international. Le développement de solutions d'IA frugales (c'est-à-dire dont le besoin en ressources est minimisé par une réflexion sur les usages et la mise en place de bonnes pratiques pour leur développement) au service de la transition écologique est l'un des quatre axes de la deuxième phase de la stratégie nationale pour l'IA. Les liens entre IA et transition écologique sont par ailleurs un sujet largement investi par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui a rédigé une feuille de route « IA et transition écologique » actualisée en novembre 2023. Un appel à projet France 2030 « démonstrateurs d'IA frugale au service de la transition écologique dans les territoires (DIAT) » vise à encourager l'appropriation de l'IA par les collectivités, à stimuler la rencontre entre les besoins des territoires et les offres des acteurs économiques, mais aussi à développer une filière autour de l'IA frugale. Tous les candidats à cet appel à projet doivent faire une évaluation a priori de l'impact carbone et de la consommation énergétique de l'entraînement et de l'utilisation de modèles d'IA. Les appels à projet qui suivront concernant l'IA, comme celui intitulé « accélérer les usages de l'IA générative dans l'économie », comprendront des critères similaires. Au-delà, un très grand nombre d'acteurs, entreprises comme associations environnementales, a exprimé dès 2023 la nécessité de disposer d'un cadre méthodologique de référence sur l'évaluation environnementale des systèmes d'IA. C'est pourquoi le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a lancé en janvier 2024 un groupe de travail sur l'impact environnemental de l'IA, en partenariat avec l'association française de normalisation (AFNOR), pour élaborer une « AFNOR-Spec IA frugale ». L'objectif est de proposer à tous les acteurs un document de référence crédible et opérationnel pour prendre en compte les impacts environnementaux de l'intelligence artificielle dans leur organisation et de permettre aux acteurs publics d'intégrer l'impact environnemental de l'IA dans les appels à projet et les marchés publics. Plus d'une centaine de participants sont impliqués dans cette rédaction. Ils sont issus de structures publiques (comme l'ADEME, l'Arcom ou l'Arcep), de grands groupes, de petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI), d'associations, du corps universitaire et de la recherche et de fédérations. À moyen terme, cette AFNOR-Spec sera portée au niveau européen pour inspirer une norme européenne sur les lignes directrices pour évaluer et réduire les impacts environnementaux de l'IA. Une norme sur la consommation d'énergie et d'autres ressources sur le cycle de vie de l'IA est en effet attendue dans le cadre du règlement européen IA (article 40 alinéa 2). Le document de référence « AFNOR-Spec » devrait être publié cet été, et servir de base à des critères élevés dans les appels à projet, être promu pour les achats privés et publics, afin de pousser le secteur à adopter des réflexes vertueux compatibles avec les principes de sobriété énergétique et de frugalité, particulièrement dans le cas de l'IA générative. Le Gouvernement est donc engagé dans le développement d'une intelligence artificielle à la fois bénéfique à notre économie et compatible avec la transition écologique, en invitant les entreprises, les territoires, les administrations et les individus à se questionner sur l'évaluation environnementale de leurs modèles, et à réaliser une analyse coût-bénéfice notamment au regard des impacts environnementaux.
- page 2487
Page mise à jour le