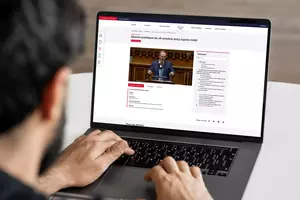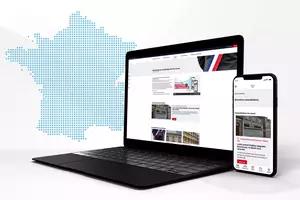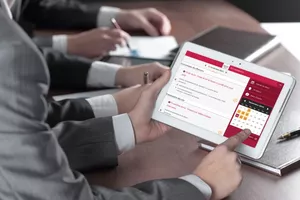Lundi 6 mai 2024
- Présidence de M. Roger Karoutchi, président -
La réunion est ouverte à 16 h 00.
Audition de M. Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas
M. Roger Karoutchi, président. - Nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France.
Nous entendons aujourd'hui M. Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas, accompagné de M. Yannick Jung, responsable Corporate & Institutional Banking (CIB) Global Banking, de Mme Laurence Pessez, directrice de la responsabilité sociale et environnementale de BNP Paribas, et de M. Sébastien Dessillons, directeur des équipes sectorielles de BNP Paribas CIB.
Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif d'une vingtaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat. La vidéo sera, le cas échéant, diffusée sur les réseaux sociaux, puis consultable en vidéo à la demande. Elle fera l'objet d'un compte rendu publié.
Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal, pouvant aller de trois à sept ans d'emprisonnement et de 45 000 euros à 100 000 euros d'amende.
Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant : « Je le jure. »
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Jean-Laurent Bonnafé, M. Yannick Jung, Mme Laurence Pessez et M. Sébastien Dessillons prêtent serment.
M. Roger Karoutchi, président. - Avant de vous céder la parole, je vous invite également à nous préciser si vous détenez des intérêts de toute nature dans le groupe TotalEnergies ou dans l'un de ses concurrents dans le secteur de l'énergie, y compris sous forme de prestations de conseil ou de participations à des cénacles financés par les énergéticiens.
Pour la bonne information de notre commission d'enquête, je rappelle que le groupe BNP Paribas a été assigné en justice par plusieurs ONG en 2022 pour non-respect de son devoir de vigilance en matière climatique et que ces ONG lui reprochent notamment son soutien financier à des entreprises pétrogazières, dont TotalEnergies. Il n'appartient bien évidemment pas à notre commission d'enquête de se prononcer sur ce contentieux et vous aurez la possibilité, monsieur le directeur général, de ne pas répondre à une question qui porterait de manière directe sur le contentieux en cours.
Avez-vous donc des intérêts de toute nature dans le groupe TotalEnergies ?
M. Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas. - Non.
M. Yannick Jung, responsable Corporate & Institutional Banking (CIB) Global Banking de BNP Paribas. - Non, aucun intérêt.
Mme Laurence Pessez, directrice de la responsabilité sociale et environnementale de BNP Paribas. - Non, je n'ai pas d'intérêt.
M. Sébastien Dessillons, directeur des équipes sectorielles de BNP Paribas CIB. - Moi non plus.
M. Roger Karoutchi, président. - Merci.
M. Jean-Laurent Bonnafé. - À titre de propos introductif, nous vous présenterons quelques dimensions de nos activités en tant que banque au service de la transition énergétique. Yannick Jung, responsable de la banque d'entreprise au niveau mondial, vous dira tout d'abord quels sont nos engagements et comment ils se déclinent. Il vous présentera également un certain nombre de réalisations et de financements pris, par exemple, l'année dernière. Laurence Pessez vous présentera la façon dont se sont succédé, dans la durée, nos différentes politiques dans tous les secteurs - charbon, gaz, pétrole - dont nous sortons progressivement ou définitivement et comment tout ceci s'est installé dans le temps et sous-tend notre trajectoire actuelle, qui fait que nous sommes relativement bien avancés, en tout cas lorsque nous nous comparons à d'autres banques globales. Enfin, Sébastien Dessillons vous parlera de l'ensemble des autres secteurs ; en effet, l'énergie est l'un des nombreux secteurs qui sont à l'origine des émissions et notre banque mène évidemment une politique sur les principaux secteurs émetteurs, au-delà du seul secteur de la production d'énergie.
M. Yannick Jung. - Mon propos sera structuré en deux temps. Tout d'abord, je vous expliquerai comment BNP Paribas se désengage méthodiquement des activités de financement de la production d'énergies fossiles et y substitue une accélération massive de son soutien aux énergies bas-carbone. Dans un second temps, je vous décrirai en quoi consiste, en pratique, cette accélération.
Auparavant, je souhaite définir rapidement trois termes que je prévois d'utiliser.
Le premier, ce sont les énergies renouvelables, ou, plus précisément, les énergies bas-carbone. Pour nous, cela recouvre les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'énergie solaire, photovoltaïque, l'éolien, la géothermie, auxquels on ajoute les biocarburants et le nucléaire. En revanche, cela n'inclut pas tout ce qui relève de l'aval, comme les réseaux de charges électriques, le stockage d'électricité ou la production de molécules vertes, par exemple l'hydrogène vert. Nous nous concentrons donc sur le bloc rassemblant les énergies renouvelables, les biocarburants et le nucléaire.
Le deuxième terme, ce sont les énergies fossiles, qui comprennent, bien entendu, le pétrole, mais aussi le gaz et le charbon, dans les dimensions d'extraction et de production, mais aussi de raffinage pour ce qui est du pétrole, pour produire de l'essence.
Le troisième terme, ce sont les financements. Lorsque je parle de financements, je veux parler des engagements que nous portons à notre bilan, en d'autres termes, des lignes de crédit qui sont octroyées à nos clients, qu'elles soient utilisées ou non.
Nous vous avons transmis un document qui contient, sur la deuxième page, un graphique. On y voit deux courbes qui se croisent. La courbe brune représente la part des énergies fossiles dans le total des financements dédiés à la production d'énergie dans le monde. La courbe verte représente la part des énergies bas-carbone. Nous voyons comment, dans le temps, notre « mix énergétique » du financement de la production d'énergie a évolué : ces deux courbes se sont croisées.
Ce graphique illustre notre stratégie, qui est simple, même si sa mise en oeuvre est complexe. Elle est construite autour de deux grands axes. Le premier, c'est le désengagement progressif du financement de la production d'énergies fossiles, entamé depuis maintenant dix ans, qui entre en phase d'accélération : c'est la courbe brune que l'on voit décroître. Le deuxième, c'est la réallocation massive de nos moyens financiers et humains vers le soutien aux énergies bas-carbone. Nous nous sommes fixé une cible de 40 milliards d'euros de financements en place d'ici à la fin de l'année 2030 : c'est la courbe verte que l'on voit monter.
Plusieurs étapes clés ont jalonné notre trajectoire de transition. En 2012, trois ans avant la COP21, la part des énergies bas-carbone dans notre bilan pour le financement de la production d'énergie n'est que de l'ordre de 10 %. En face, 90 % de ces financements sont fléchés vers les énergies fossiles. Au moment des accords de Paris, en 2015, le mix s'est un peu amélioré : 25 % pour le vert, 75 % pour le brun. Les deux courbes se croisent ensuite quelque part en 2021. En septembre 2022, nous avons rendu publics, pour la première fois, nos relevés de mesure. À ce moment-là, l'empreinte bas-carbone dans notre bilan est passée à 54 %, là où la part des financements consacrés aux énergies fossiles est tombée à 46 %. Un an plus tard, en septembre 2023, les deux courbes se sont fortement écartées : deux tiers de notre portefeuille de financements sont alors dirigés vers la production d'énergies bas-carbone, et seulement un tiers vers les énergies fossiles. Fin septembre 2023, 32 milliards d'euros de financements sont utilisés pour les énergies bas-carbone. En face, il n'y a plus que 17 milliards d'euros résiduels pour les énergies fossiles. Plus de la moitié de ces 17 milliards d'euros correspondent au financement des capacités de raffinage pour produire de l'essence. Je ne détaillerai pas la composition de ces deux agrégats, mais si vous avez des questions sur ce point, je serais ravi d'y répondre.
Cela vous montre l'importance du travail que nous avons déjà accompli depuis dix ans. Je pense que cela prouve qu'en étant systématique et déterminé on peut commencer à obtenir des résultats. Ce travail se poursuivra et s'accélérera dans les années qui viennent. Notre plan de marche doit nous permettre de ramener le poids du stock résiduel de financements des énergies fossiles à moins de 20 % d'ici à la fin de l'année 2028 et à moins de 10 % d'ici à 2030 avec, en face, 90 % du stock de financement consacré aux énergies bas-carbone. En d'autres termes, en 2030, nous aurons un rapport exactement inverse de celui de 2012 : 90 % de vert, pour 10 % de brun. Cela vous montre l'ampleur de la transformation de nos activités de financement qui aura été accomplie en moins de deux décennies.
En pratique, d'ici à la fin de 2030, nos encours résiduels de financement sur la production et l'exploration de pétrole seront tombés en dessous de 1 milliard d'euros, soit une division par cinq par rapport au niveau de 2022. Pour ce qui est du gaz, nous nous sommes fixés pour cible une baisse de 30 % à cet horizon, mais nous pouvons d'ores et déjà vous dire que cet objectif sera largement dépassé.
L'accélération survenue en 2023, que je mentionnais précédemment, est née du fait qu'en janvier et mai 2023 nous avons publiquement explicité les mesures concrètes que nous prenions pour nous désengager du financement de la production d'hydrocarbures, afin de pouvoir réallouer massivement notre capital, notre bilan ainsi que le temps de nos équipes et leur savoir-faire vers le financement de la production d'énergies bas-carbone.
Ce plan d'action de désengagement se résume en quatre mesures. La première mesure est l'arrêt de tous les financements consacrés au développement de nouveaux champs, pour le gaz comme le pétrole, et ce quelles que soient les modalités de financement. La deuxième mesure se concentre sur l'arrêt complet du financement des sociétés spécialisées dans l'exploration et la production de pétrole, qui ont été présentées comme indépendantes lors de certaines de vos auditions passées. La troisième mesure est la réduction graduelle des parts de crédits généralistes destinés aux grands énergéticiens intégrés, aussi appelés « majors », qui sont attribuables à l'exploration et à la production d'hydrocarbures. Enfin, la dernière mesure, la plus importante, concerne l'augmentation de nos financements vers la production d'énergie bas-carbone, avec notamment l'énergie renouvelable en ligne de mire. C'est l'objectif de 40 milliards d'euros que j'évoquais plus tôt.
Un point d'importance : ce n'est pas parce que nous avons décidé de ne plus octroyer de nouveaux crédits que les financements qui ont été accumulés au fil des années vont disparaître du jour au lendemain. Il faut maintenant que l'on pilote ce désengagement. Or ce pilotage se fait via la non-production de nouvelles activités, ainsi qu'au moyen de l'amortissement contractuel des crédits existants, de sorties planifiées lors d'événements de refinancement et, en certains cas, à travers des cessions de créances.
En pratique, depuis début 2023, c'est-à-dire depuis un an, nous nous sommes abstenus de participer à de très nombreux financements, que ce soit sous forme de crédits syndiqués ou de financements obligataires.
Faute de temps, je ne vous parlerai pas de la façon dont nous nous positionnons dans les classements sur ces types de financement à l'échelle mondiale, mais je serais très heureux de répondre à vos questions si un intérêt se présente sur ce point.
En revanche, je souhaite vous dire simplement et clairement une chose : BNP Paribas ne finance pas l'expansion des ressources en hydrocarbures. Nous ne finançons pas la production d'hydrocarbures. Cette page est définitivement tournée en ce qui nous concerne.
Tout ce que je viens de vous dire a l'air simple, mais, dans les faits, c'est le fruit de beaucoup de travail. C'est un travail méthodique, systématique, qui est fait avec beaucoup de sérieux, de discipline, de détermination depuis plusieurs années maintenant. En outre, cela n'est pas sans incidence financière sur notre activité.
Comme vous l'avez entendu au fil des auditions, la transition énergétique - le fait de remplacer les énergies fossiles par des énergies bas-carbone - est un processus complexe, qui s'inscrira dans le temps et nécessitera beaucoup de travail. C'est la raison pour laquelle, chez BNP Paribas, nous nous efforçons d'agir de manière aussi graduelle, équilibrée, réfléchie que possible, en prenant en compte toute une série de dimensions : dimensions économique, sociale, réglementaire, géopolitique et, bien sûr, scientifique. Tout ce que nous avons fait, à chacune des étapes, s'inscrivait dans les politiques fixées par l'Europe et par la France.
C'est aussi pour cette raison que le second pan, essentiel, de notre stratégie est de faire de la transition bas-carbone notre priorité absolue. C'est la raison pour laquelle, il y a maintenant trois ans, nous avons créé une équipe dédiée, de 200 banquiers, que nous avons appelée « groupe de transition bas-carbone ». Ces professionnels, tous issus du domaine de l'énergie, se consacrent entièrement à deux choses : faciliter l'émergence de grands projets finançables dans le domaine de la production d'énergie bas-carbone et aider nos grands clients industriels à décarboner leurs propres cycles d'opération.
Faute de temps, je ne détaillerai pas tout ce que fait le groupe BNP Paribas par ailleurs sur ses autres segments de clientèle - particuliers, très petites entreprises (TPE), petites et moyennes entreprises (PME), entreprises de taille intermédiaire (ETI) - mais nous faisons beaucoup de choses. Et je serai ravi de répondre aux questions sur ce point si vous en avez.
M. Yannick Jadot, rapporteur. - La courbe des financements consacrés aux énergies bas-carbone et renouvelables augmente. Que reste-t-il qui sera consacré aux énergies fossiles dans votre portefeuille jusqu'en 2030 ? La courbe brune est descendante, mais que contient-elle ?
M. Yannick Jung. - Vous y retrouverez des financements ayant une durée de vie longue et dont la maturité dépasse 2030. Je vais vous donner un exemple, tiré d'une activité que nous avons totalement cessée : c'est le financement de ce que l'on appelle les FPSO, ou Floating Production Storage and Offloading. Cela désigne les unités flottantes de production et de stockage pour les champs de pétrole en mer. Ces actifs ont une durée de vie très longue et les financements associés avaient des durées de vingt-cinq, trente, voire trente-cinq ans. Nous avons aujourd'hui dans notre bilan des actifs de cette durée. Nous avons essayé d'en vendre certains, sans y parvenir. Nous en avons vendu d'autres, mais nous sommes condamnés à les garder dans notre bilan au-delà de 2030.
M. Yannick Jadot, rapporteur. - Peuvent-ils contribuer à une augmentation de la part de financements consacrés aux énergies fossiles ?
M. Yannick Jung. - De toute façon nous n'en faisons plus, c'est fini. Les équipes qui étaient chargées de ces activités ont été démantelées.
Nous avons également des actifs de financements plus longs adossés à des réserves. Certains acteurs indépendants présentent ainsi des maturités qui dépassent 2030. Nous essaierons de gérer cela. Des événements de refinancement surviendront peut-être, à l'occasion desquels nous pourrons nous désengager.
Dernier élément : vous trouverez trace de nos participations dans des financements syndiqués pour certains grands énergéticiens que nous avons décidé de continuer à accompagner car nous considérons qu'ils ont une stratégie de transition crédible. Nous travaillons justement avec eux sur leur projet de transition. Ils ancrent leur groupe de banques relationnelles à travers des financements syndiqués qui ont pour vocation d'assurer leurs liquidités ou des lignes de crédit de précaution, utilisées pour rassurer à la fois les agences de notation et leurs actionnaires sur leur capacité à faire face à des événements imprévus susceptibles d'avoir un impact sur leur trésorerie.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Vous avez dit que vous n'incluiez pas l'aval dans vos financements consacrés aux énergies bas-carbone : recharges, batteries, molécules, etc. Pourquoi ?
Par ailleurs, vous êtes passé un peu rapidement sur un sujet qui doit vous préoccuper compte tenu de votre métier, à savoir l'incidence financière de ces choix. Pouvez-vous y revenir ?
M. Yannick Jung. - Nous sommes très impliqués dans tout ce qui relève du développement de l'écosystème bas-carbone, autour des molécules vertes - hydrogène vert, ammoniac vert, transport et stockage associés - ainsi que dans la réflexion autour de l'électrification des usages, dans la mobilité à travers les batteries ou les bornes de recharge ou dans le secteur de l'industrie lourde. Je pense à l'aciérie, par exemple, où l'on peut basculer sur la production d'acier en utilisant de l'électricité verte. BNP Paribas est très impliqué dans ce domaine.
Le choix que nous avons fait pour la construction de nos agrégats, que reflète le chiffre de 32 milliards d'euros relevé à fin septembre 2023, c'est de nous limiter à l'énergie primaire. C'est la logique. Il est possible que la façon dont nous comptabilisons toute notre activité évolue dans le temps, au fur et à mesure que ces technologies mûriront.
Par ailleurs, l'ensemble des revenus que nous générons avec ce que l'on pourrait appeler le secteur pétrogazier au sens large, qui inclut, outre la production et l'exploitation de pétrole et de gaz, le transport à travers des gazoducs ou des pipelines, le stockage, ou encore les équipementiers, est inférieur à 0,2 % des revenus de BNP Paribas consolidés actuellement à l'échelle mondiale. En 2022, ces revenus étaient supérieurs d'environ 10 %. On s'attend à ce qu'ils se réduisent encore d'environ 20 % cette année.
M. Jean-Laurent Bonnafé. - Sortir coûte tous les ans un peu plus cher, mais c'est le prix à payer. Nous remplaçons cette ancienne filière par une nouvelle, qui fait de nous le leader mondial du bas-carbone.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Il n'est pas interdit de penser que vous investissez dans des choses rentables...
M. Jean-Laurent Bonnafé. - Nous changeons de métier.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Quel est l'impact sur vos résultats ? Quel engagement financier cela vous fait-il prendre ? Ce n'est pas colossal, finalement.
M. Jean-Laurent Bonnafé. - Le revenu instantané était très connu, très prévisible, et très bas. Nous le savons, le monde nouveau peut contenir un certain nombre d'inconnues : dans l'éolien, le solaire, les batteries. Sur le plan de la rentabilité, ce n'est pas du tout la même chose. Néanmoins, il en va de même dans l'industrie automobile. Elle pivote du moteur à essence ou du moteur diesel vers un moteur électrique. C'est une autre technologie, à laquelle il faut s'adapter. Il se produit le même type de bascule. On sera toujours dans le financement de la production d'énergie, mais, alors qu'il concernait quasi essentiellement les énergies fossiles, il concerne désormais quasi essentiellement les énergies bas-carbone, et il le concernera exclusivement à un horizon que l'on peut fixer à 2035.
Par conséquent, notre activité change et c'est un apprentissage compliqué. Cela nécessite de disposer d'effectifs aux compétences plus pointues, car ce domaine est moins connu. Sans cet investissement immatériel, nous ne pourrions pas analyser les importants projets de demain, comme les grandes usines de batteries, et constituer des financements. Sans cela, un projet peut exister, mais personne ne s'y embarquera. Dans ce domaine, notre rôle est souvent d'analyser et de structurer le financement du projet dans son ensemble, puis de syndiquer ce financement avec d'autres banques. Ce rôle pivot explique notre position de leader mondial aussi bien dans le secteur du financement vert que dans celui de l'obligataire vert.
M. Yannick Jung. - C'est ce que nous avons voulu montrer sur la carte de l'Europe figurant sur la deuxième page du document. L'électricité verte est au coeur de la transition énergétique, car c'est une condition essentielle de la décarbonation des économies et elle constitue un facteur d'indépendance énergétique important pour l'Europe. Sur cette carte figurent 17 grands projets européens d'énergies renouvelables - 2 se situent en France -, pour lesquels BNP Paribas a structuré la dette et construit les financements. Leur capacité de production, supérieure à 15 gigawatts, permettra de répondre aux besoins annuels en électricité de plus de quinze millions de foyers européens. J'évoquerai uniquement deux d'entre eux.
Le projet Dogger Bank est le plus grand parc éolien maritime au monde. Situé au Royaume-Uni et d'une capacité de 3,6 gigawatts, il approvisionnera en électricité six millions de foyers britanniques. BNP Paribas a joué de multiples rôles et je peux dire, en toute modestie, que ce projet n'aurait sans doute pas vu le jour sans notre implication.
Le second projet concerne trois parcs d'éoliennes en mer, situés en France au large de Saint-Nazaire, de Fécamp et de Courseulles-sur-Mer, et développés par EDF Renouvelables. Le champ d'éoliennes situé au large de Saint-Nazaire commence à entrer en production - c'est le premier des trois -, alors que nous travaillons sur ces projets depuis 2014, ce qui donne une idée du temps de gestation de ce type de projets industriels. À cette occasion, nous avons défini, avec EDF Renouvelables, le cadre de développement de l'industrie de l'éolien en mer français.
Notre implication dans le secteur des énergies renouvelables ne se limite pas à ces grands projets ; nous avons aussi aidé au développement et au financement de plusieurs dizaines de projets régionaux en France. En tant que grande banque internationale, notre champ d'intervention n'est pas restreint à l'Europe. En 2023, nous avons aidé à financer le plus grand projet d'énergies renouvelables au monde, SunZia, qui est situé aux États-Unis.
Pour répondre à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, au-delà de l'électricité verte et des électrons verts, nous intervenons dans toute la chaîne de valeur industrielle, notamment en matière d'électrification des usages et de développement des molécules vertes que sont l'hydrogène ou l'ammoniac. Dans le secteur de la mobilité, BNP Paribas est la principale banque du très beau projet industriel français, à dimension européenne, Automotive Cells Company (ACC), présenté par M. Carlos Tavares lors de son audition. Cette coentreprise entre Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies a pour objectif de produire des batteries pour les véhicules électriques. En matière d'application industrielle, BNP Paribas a aidé à mettre en place un financement de plusieurs milliards d'euros, signé en fin d'année dernière, pour le projet H2 Green Steel, situé en Suède. Cette première grande aciérie verte en Europe utilisera de l'énergie verte pour produire de l'acier. Le produit final aura ainsi une empreinte carbone jusqu'à 95 % inférieure à celle d'un produit traditionnel.
Voilà des exemples concrets de notre engagement auprès de nos clients pour les aider dans leur transition vers une économie bas-carbone.
Mme Laurence Pessez. - Comme Jean-Laurent Bonnafé l'indiquait, notre engagement ne date pas d'hier. Dès 2010, nous avons placé la transition énergétique - on employait alors, avant l'accord de Paris, non pas cette expression, mais celle de lutte contre le changement climatique, aujourd'hui quelque peu désuète - au coeur de nos priorités environnementales et l'une de nos toutes premières politiques de financement et d'investissement a concerné la production d'électricité à partir du charbon.
Les politiques de financement et d'investissement sont des documents publics qui définissent les critères obligatoires que nos entreprises clientes et celles dans lesquelles nous investissons doivent respecter pour des activités tant de financement que d'investissement pour le compte de tiers. Cela s'applique donc à toutes les activités de la banque.
Pour ce qui concerne les activités de financement, ces critères s'appliquent au moment de l'entrée en relation avec le client, mais aussi lors de la revue périodique des risques relatifs aux clients existants et au moment de l'octroi de crédit. Dans le cadre de notre stratégie de désengagement progressif du soutien aux énergies fossiles, nous avons commencé par le charbon, car c'est la source d'énergie la plus émettrice de gaz à effet de serre. Une première politique a été définie en 2010, puis progressivement durcie. Ainsi, en 2015, les financements de centrales électriques dans les pays à hauts revenus ont été arrêtés, comme ceux qui étaient liés à l'extraction de charbon thermique. Finalement, en 2020, nous avons décidé d'arrêter complètement de financer la chaîne de valeur du charbon, à l'horizon 2030 en Europe et dans les pays de l'OCDE, et à l'horizon 2040 dans le reste du monde.
Nous n'avons pas attendu cette échéance pour nous préoccuper du sujet et savoir si nos clients s'inscrivaient dans nos objectifs. Aussi, dès 2020, nous avons passé en revue l'intégralité de notre portefeuille de producteurs d'électricité et d'acteurs miniers afin d'évaluer leurs capacités à honorer nos attentes dans les délais fixés : la moitié d'entre eux n'envisageait pas de sortir du charbon aux dates déterminées, certains prévoyaient même la mise en service de capacités additionnelles. Par conséquent, nous avons engagé une sortie de relation avec une cinquantaine de clients, soit environ la moitié de notre portefeuille. La politique de financement et d'investissement a donc un réel effet.
Nous nous sommes ensuite assez logiquement attaqués à la deuxième source d'énergie la plus émettrice de gaz à effet de serre : les pétroles et gaz non conventionnels, à savoir le pétrole et le gaz de schiste ainsi que les sables bitumineux, principalement produits aux États-Unis et au Canada. Notre première politique de financement et d'investissement pour le secteur du pétrole et du gaz a été publiée en 2017 et était centrée sur les acteurs dont le modèle d'affaires était tourné vers l'exploration et la production de ces énergies fossiles. Dans la mesure où ils n'avaient pas la possibilité de se diversifier et que la production de ce type d'énergies est totalement incompatible avec l'objectif de maintien du réchauffement climatique en deçà de la limite fixée par l'accord de Paris, nous avons, là encore, décidé de cesser de financer ces acteurs, ainsi que les infrastructures de transport - pipelines ou terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié - alimentées par un important volume de pétrole ou de gaz non conventionnels.
En 2017, BNP Paribas était la première des trente-cinq plus grandes banques internationales à prendre une telle décision ; nous étions donc des pionniers. Notre politique a eu un réel effet dans ce domaine également. En effet, notre exposition de crédit pour ces acteurs spécialisés, qui s'élevait à 4 milliards d'euros en 2017, a été réduite à zéro en 2021 : quatre ans ont été nécessaires pour que tous les financements arrivent à échéance.
Cette politique de financement et d'investissement ayant trait aux pétroles et gaz non conventionnels, à l'origine centrée sur les entreprises spécialistes qui ne pouvaient pas se diversifier, s'est étendue, en 2020 et en 2022, aux acteurs diversifiés comme les majors, dont une partie de la production provient de sources non conventionnelles, et aux acteurs présents dans les régions sensibles, pour ce qui concerne le climat, la biodiversité et les droits humains, que sont l'Arctique et l'Amazonie. En mai 2023, nous avons actualisé notre politique pour refléter les engagements pris dans le cadre de l'alignement de nos financements en faveur du secteur du pétrole et du gaz avec un scénario de zéro émission nette, ou Net Zero Emissions Scenario, en 2050. Nous y avons fait figurer les leviers évoqués par Yannick Jung : l'arrêt des financements des nouveaux champs de pétrole et de gaz, ainsi que l'arrêt programmé des financements aux indépendants pétroliers, qui sont les conditions sine qua non pour atteindre nos objectifs très volontaristes de réduction de nos financements à l'exploration et à la production de gaz. Nous y précisons également les critères d'analyse des plans de transition de nos clients.
M. Yannick Jung. - Je souhaite corriger un chiffre : le poids de l'ensemble du secteur pétrogazier est inférieur à 1,3 % des revenus mondiaux de BNP Paribas. L'ordre de grandeur indiqué précédemment avait trait uniquement à mes activités.
M. Sébastien Dessillons. - Pour conclure ces propos introductifs, nous voulions souligner nos engagements qui, au-delà du domaine des énergies fossiles, visent à accompagner la décarbonation de dix secteurs figurant parmi les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'alliance bancaire Net Zero, ou Net-Zero Banking Alliance (NZBA), qui est une coalition internationale de 144 banques, dont BNP Paribas est l'un des membres fondateurs. Depuis le lancement de cette initiative voilà trois ans, nous nous sommes fixé des objectifs de décarbonation de nos financements associés pour ces dix secteurs : tout d'abord, en 2022, pour le pétrole et le gaz - nous l'avons évoqué -, pour la production d'électricité et pour l'automobile ; ensuite, en 2023, pour les secteurs de l'acier, de l'aluminium et du ciment ; enfin, dans le cadre de notre prochain rapport Climat, qui sera publié dans quelques jours, pour les secteurs du transport maritime, du transport aérien, de l'immobilier commercial et résidentiel, ainsi que de l'agriculture.
Ces sujets sont techniquement très complexes et nous les abordons avec beaucoup d'humilité. Nous apprenons en marchant, ce qui nécessite de dialoguer avec nos clients, les industriels et les sachants des différents secteurs. Il s'agit de comprendre à quelle étape du cycle de production les émissions de CO2 sont les plus importantes, quelles sont les transitions industrielles à l'oeuvre, dans quelle situation sont nos clients aujourd'hui et dans quelle direction ils se projettent à l'horizon de cinq ou dix ans, quelles sont leurs capacités pour mettre en oeuvre leurs ambitions et, in fine, pour soutenir leur transition. Il s'agit ensuite de nous fixer des objectifs pour contribuer, par nos financements, à leur transition.
Les objectifs de décarbonation de nos financements pour ces secteurs sont définis en termes d'intensité d'émissions : nous calculons la quantité d'émissions de gaz à effet de serre par unité physique. Notre stratégie est ici différente de celle d'un désengagement progressif défini pour le secteur Oil and Gas, du pétrole et du gaz. En effet, l'objectif est de conduire ces secteurs économiques et industriels à utiliser les ressources fossiles le plus efficacement possible afin de réduire les émissions de CO2 d'une production ou d'une unité physique. Ainsi l'intensité d'émissions est-elle mesurée, pour l'automobile, en grammes de CO2 par kilomètre parcouru ou, pour la production d'énergie, en grammes de CO2 par kilowattheure. Ce sont des objectifs non pas de réduction de notre exposition, mais d'allocation de nos financements de la façon la plus efficace au regard de la transition énergétique. À ce jour, les indicateurs retenus à la fin de l'année 2023 soulignent que nous suivons les trajectoires définies, qui sont comparées aux scénarios produits notamment par l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Nous nous attelons, avec beaucoup de sérieux, à cette mise en oeuvre ordonnée et graduelle de la décarbonation de nos financements dans ces secteurs. Il s'agit de piloter notre trajectoire et d'accompagner nos clients, en matière de financement et de conseil, pour leur propre trajectoire. Ces sujets figurent souvent aux premiers rangs de leurs préoccupations et sont très importants dans notre relation commerciale.
M. Roger Karoutchi, président. - En dehors du secteur des hydrocarbures, vous conseillez des clients, issus de plusieurs secteurs - de nouveaux s'ajouteront prochainement -, en matière de transition énergétique. Quelles entreprises, ou quels types d'entreprises, ont le plus de réserves à s'engager dans cette voie et, selon vous, pour quelles raisons ? Est-ce pour des motifs financiers ? Certains secteurs sont-ils moins faciles à décarboner que d'autres ?
Ensuite, si certains soutiennent qu'il ne faut plus développer de nouveaux projets d'hydrocarbures, d'autres soulignent que la consommation mondiale d'hydrocarbures continue d'augmenter, pour le moment. Vous vous désengagez complètement de ce secteur ; la plupart des banques que nous avons interrogées ont d'ailleurs fait une déclaration similaire, car elles souhaitent participer à la transition énergétique. Comment les nouveaux projets des entreprises du secteur des hydrocarbures, pas seulement TotalEnergies, sont-ils financés ? Quel type de banques interviennent encore dans ce domaine ? S'agit-il de banques asiatiques ou américaines ? Des banques européennes continuent-elles d'investir ?
M. Jean-Laurent Bonnafé. - Le secteur pétrogazier est assez différent des autres secteurs. En effet, en raison du niveau actuel des prix, il est extrêmement rentable. Si l'on observe la partie historique de l'une de ces grandes entreprises, leur cash flow ou flux de trésorerie net, qui est en quelque sorte sa capacité d'investissement, permet de rembourser les financements passés, de réaliser des investissements, de payer les impôts et de distribuer des dividendes ou de racheter des actions.
Ces entreprises ont besoin de financements externes à deux titres. D'une part, pour les grands ou les nouveaux projets, les entreprises du secteur ont l'habitude, en dépit de leurs bénéfices, de structurer des financements ad hoc ; c'est le cas en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde. Ce sont alors les banques nord-américaines ou asiatiques, notamment japonaises, qui financent la plupart du temps. Les banques européennes sont en voie de sortie, si je puis dire. D'autre part, les entreprises du secteur réalisent bien moins d'émissions obligataires qu'auparavant, car le niveau de profitabilité est tel que le besoin en la matière est bien plus faible.
Au regard de l'analyse des cash flows, les grands acteurs européens, comme BP, Equinor, Shell, Eni ou Repsol, représentent une part importante des investissements dans le bas-carbone. Cette part est en croissance ; c'est particulièrement vrai pour TotalEnergies. Pour le moment, il n'est pas dans la pratique de ces entreprises de se consacrer aux émissions obligataires vertes, dont la seule finalité est de financer un tel secteur ; elles se limitent aux obligations conventionnelles pour que leur approche reste équivalente à celle des grands compétiteurs nord-américains.
Pour notre part, nous nous en sommes retirés, parce que certains affirmaient que de telles obligations, générales par nature, étaient susceptibles de financer tout et son contraire. En réalité, l'analyse des cash flows laisse penser que, à cet instant du cycle, cette remarque n'est pas tout à fait exacte ; néanmoins, nous avons indiqué à l'ensemble de nos clients que, selon nous, il convenait de financer le bas-carbone au travers d'obligations vertes. Ainsi, quand les entreprises peuvent le faire, elles le font et, si elles ne le font pas, pour des raisons qui leur sont propres et qui peuvent être variées, nous ne les accompagnons pas.
L'Europe est, pour le moment, plus volontaire en matière de transition et sa réglementation est probablement plus structurée, plus avancée. Dans d'autres zones, comme aux États-Unis, en Inde, en Chine ou en Indonésie, les données démographiques font que la consommation de charbon augmente en valeur absolue, malgré la baisse relative de cette source d'énergie dans le mix. Ces pays n'ont pas le choix, dans l'attente que le nucléaire ou le bas-carbone prennent le relais. Les cycles sont différents.
L'Amérique du Nord ne connaît pas le cadre de contraintes que développe l'Europe. Pour autant, les États-Unis ont développé le numéro un mondial du véhicule électrique, ils battent tous les ans le record du nombre de centrales thermiques classiques mises à l'arrêt et ils disposent, tant dans le nucléaire que dans le solaire, des meilleures technologies. Chacun sa culture !
Il est certain que certains régulateurs, comme la Réserve fédérale américaine, la Fed, considèrent ne pas devoir se mêler de la transition menée par les banques. Ces superviseurs ne sont pas dans une optique de pilotage ferme ou d'encadrement, même si l'aléa physique - les inondations ou les tornades - est susceptible d'abîmer les actifs financés par les banques et d'avoir ainsi un effet indirect. La Banque centrale européenne (BCE), quant à elle, s'inscrit dans une logique bien plus active.
Dans tous les cas, la méthode employée doit être soutenable. Il faut regarder les portefeuilles des banques : ne pas envisager, lors des stress tests, de la même manière les actifs qui s'éteindront cinq ans plus tard et ceux qui existeront encore trente ans - ces calculs sont toujours très compliqués et fragiles, les chiffres n'étant pas tous disponibles et les évolutions étant difficiles à modéliser.
Au travers de ses lois et de ses règlements, l'Europe est sans doute, malgré les nuances entre pays, la région la plus déterminée. D'autres réglementent moins, mais progressent. Je ne veux pas dire que tout va bien, mais, en Chine, des pas de géant ont été faits dans les véhicules électriques, ainsi que dans des infrastructures que nous pouvons pour partie leur envier. Quelle que soit la technologie, les États-Unis sont toutefois leaders.
Pour les entreprises du secteur pétrogazier qui veulent émettre des obligations conventionnelles ou qui souhaitent des financements globaux, dits corporate, les sources de financement sont presque sans limites. Étant donné qu'elles ne rencontrent aucun problème, elles ne voient probablement pas d'intérêt pratique aux émissions vertes.
Les investissements avancent, les acteurs s'améliorent. Pour les secteurs du ciment et de l'acier, les entreprises doivent revoir leurs technologies - parfois, elles ne sont pas intégralement maîtrisées ou maîtrisables à l'heure qu'il est - et la valeur ajoutée dans leur chaîne. Il leur faut migrer d'un financement à l'autre, ce qui exige beaucoup d'efforts.
Pour l'automobile, les deux sujets principaux sont les batteries, qui posent la question des ressources en minerais, et le réseau de distribution. Il faut de l'énergie bas-carbone, à partir de sources « vertes » ou « roses », pour obtenir de l'hydrogène. Ce dernier peut être produit en grande quantité puisque la France et l'Europe disposent de nucléaire, tout comme les États-Unis et la Chine. Toute une filière hydrogène viendra combler certains interstices : machinisme agricole, poids lourds, voitures de grande taille, transport maritime et aérien, immobilier commercial ou résidentiel... Pour faire face aux besoins, il faut des infrastructures : des stations de recharge. L'enjeu est complexe, entre privé et espace public, mais les bonnes volontés ne manquent pas et le niveau d'investissement est fort.
L'agriculture est probablement le secteur le plus difficile à orienter vers le bas-carbone, car il est émietté en une grande diversité d'acteurs, de toutes tailles et de toutes natures. Les progrès y sont plus compliqués et plus lents. Il faudra, avec beaucoup de soins, un véritable changement culturel pour réaliser des avancées en bon ordre, sans provoquer de phénomènes de rejet qui conduisent à un retour en arrière, et de la régularité, en suivant une ligne aussi droite que possible, sachant qu'un tel chemin n'est pas toujours le plus adapté.
Il faut tenir compte à la fin de la réalité économique. Comme les taux d'intérêt monétaires, le coût de l'énergie est un élément cardinal qui détermine la capacité à se développer. Objectivement, à l'heure actuelle en Europe, même si le continent a passé le pire de la crise liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le coût de l'énergie reste sensiblement plus élevé qu'en Chine ou aux États-Unis d'Amérique. Il faut y prêter attention. L'énergie est à la base des capacités et de l'efficacité d'un grand nombre de filières industrielles et donc d'emplois.
M. Yannick Jadot, rapporteur. - Monsieur le directeur général, comment expliquez-vous le fossé qui existe entre la présentation que vous venez de nous faire, l'image que vous avez de vos activités, et les chiffres publiés régulièrement par les experts et les ONG sur votre portefeuille d'investissements dans l'énergie ? D'après ces statistiques, vous seriez encore très majoritairement présents dans le fossile, en matière de financement des projets ou des entreprises, ou par le biais d'émissions obligataires. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes propose d'augmenter les ratios prudentiels dans une logique de renforcement des coûts de financement des projets relatifs aux énergies fossiles et des acteurs pétrogaziers. Puisque, d'après vous, vos fonds se dirigent vers les comportements vertueux, n'avez-vous pas vous-même intérêt à réclamer, au travers des coalitions bancaires dont vous faites partie, davantage de réglementation et de législation afin de sanctionner les investissements dans les énergies fossiles et de rendre votre méthode plus rentable ?
De plus, votre stratégie s'applique à tous les acteurs pétrogaziers. Or on est passé d'investissements dans des projets, souvent très lourds, à des investissements dans les entreprises, par exemple au travers d'émissions obligataires. Au-delà de la question des obligations vertes, qui est une façon assez générale d'obtenir des fonds, Equinor consacre strictement 99 % de ses financements aux projets verts. S'agit-il d'une de vos stratégies potentielles ?
Enfin, pour revenir sur la sortie du pétrole, du gaz et du charbon, vous n'avez pas mentionné les infrastructures : gazoducs, oléoducs, terminaux gaziers... Comment décidez-vous, en cohérence avec vos engagements, de votre politique d'investissement ? Je pense aux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL), au regard de l'origine de cette source d'énergie et de la part malheureusement toujours plus importante du gaz de schiste américain.
Jean-Laurent Bonnafé. - Premièrement, le décalage entre image et réalité provient de certaines organisations d'essence purement locale. Dans les référencements d'organisations ayant une expertise pour juger du positionnement des banques de manière globale, nous sommes toujours très bien placés, sinon classés systématiquement comme les meilleurs. Certes, ces études sont en anglais, mais nous y figurons au-dessus de la pile. C'est la réalité ! Les traductions sont disponibles pour tout le monde.
Souvent, l'image que certains essaient de donner de nous s'explique par une sorte d'abus de langage, si je puis dire. Ce qui compte dans une banque, c'est le financement qui est « au travail » : on peut faire un crédit d'un montant N pendant dix ans ou faire chaque année pendant dix ans un crédit de même montant... Mais, dans de nombreuses méthodologies qui tendent à nous attribuer d'énormes financements du fossile, un crédit renouvelé tous les ans est compté dix fois de suite alors qu'il s'agit du même ! Par conséquent, plus la durée de l'investissement est importante, plus les chiffres sont élevés.
En 2020, pendant la pandémie, le marché de l'énergie a connu une disruption. Or il faut assurer la liquidité de ce marché, et cela passe par le biais de bourses sur lesquelles sont pratiqués les échanges et même une entreprise comme TotalEnergies en a besoin ! Il lui a donc fallu démontrer sa liquidité compte tenu d'une potentielle élévation des prix, induisant des besoins énormes. L'entreprise a alors demandé à ma banque et au Crédit Agricole de mettre en place un filet de sécurité au travers d'une ligne back-up de 8 milliards d'euros. Nous avons partagé en deux cette ligne de précaution, la syndiquant auprès d'autres banques pour une durée de 365 jours.
Cette ligne n'a jamais été tirée. Pourtant, une grande partie des personnes qui dressent de nous un profil épouvantable ont déclaré que nous financions à hauteur de 8 milliards d'euros divers projets d'exploration ou de production partout dans le monde, comme ceux qui sont menés au Mozambique ou en Ouganda. C'est faux ! Même si la durée du « filet » se limitait à un an, il nous est toujours collé statistiquement sur des périodes longues le fait d'avoir participé à cette ligne pour 4 milliards d'euros.
À l'époque, nous avons accompli notre devoir de banque, qui, lors d'une crise, sert à donner de la liquidité. Durant les trois mois du premier épisode de covid, BNP Paribas, à travers le monde mais principalement en Europe, a été à l'origine de 400 milliards d'euros de financement, dans tous les secteurs, sous la forme d'émissions obligataires, de financements syndiqués et d'émissions d'actions. En pointe, sur la période, nous avons représenté 60 % du marché.
Nous recevons de certaines organisations, y compris françaises, des courriers de satisfecit, nous félicitant de notre politique tout en nous encourageant à faire mieux encore. Même s'il est toujours possible de s'améliorer, nous sommes une entreprise, aussi faut-il nous laisser définir nos objectifs et nous accorder un minimum de liberté dans la façon de les atteindre. Compte tenu de cibles multiples, une banque doit déterminer à un instant t son parcours et s'appuyer sur les bonnes technologies, lesquelles peuvent correspondre à différents types de financement en bilan ou en hors bilan. Il est impossible d'en dessiner présentement le détail !
Notre réalité actuelle prend appui sur des décisions anciennes. Par exemple, notre politique en matière de charbon date de 2010. Nous n'avons pas attendu d'être sifflés, réprimés ou envoyés au tribunal ! Nous avons une volonté forte d'effectuer notre transition : les chiffres sont les chiffres, même si certains peuvent toujours les contester. En tant que simple ingénieur des mines, je n'ai peut-être pas un talent de communication suffisant. Que tous ceux qui affirment que nous pourrions faire mieux regardent les actions des autres : Amérique du Nord, Asie... Même si nous ne sommes pas parfaits, notre résultat est bien meilleur.
Deuxièmement, dans l'ensemble, je ne pense pas que le supplément de réglementation soit une solution. La France et l'Europe édictent déjà énormément de règles exigeantes et contraignantes, particulièrement dans le secteur bancaire. Même si leur effet est positif, le mieux est l'ennemi du bien... Il faut être réaliste. Je ne sais pas comment ont été élaborés les rapports que vous évoquez. Disposant d'une solide base scientifique, je les trouve contestables de A à Z ! Nous ne savons rien des hypothèses utilisées ni de la manière de lire les chiffres, car nous n'avons jamais été consultés, comme si quelqu'un indiquait en regardant de l'extérieur si une usine était ou non aux normes, restant à la surface des choses. Par conséquent, je n'estime pas que de tels rapports doivent nous guider.
L'important est plutôt d'avoir accès aux infrastructures de financement, quelles qu'elles soient : banques, compagnies d'assurances, gestionnaires d'actifs (asset managers)... Nous tenons à nous inscrire dans notre sphère d'appartenance, aussi nos politiques sont-elles conformes aux règles françaises, européennes et globales, et aux indications de l'AIE. Toutefois, il faut laisser les entreprises fixer leurs objectifs et les juger sur leurs réalisations, en leur laissant la capacité d'agir.
Troisièmement, faire peser davantage de charges sur le capital brun et moins sur le vert n'est pas une bonne idée. En effet, à la fin, tout sera vert...
M. Yannick Jadot, rapporteur. - Bonne nouvelle !
Jean-Laurent Bonnafé. - Dans ce cas, en tant que banque, mon portefeuille sera plus risqué qu'un autre comprenant seulement du brun. C'est un fait !
M. Yannick Jadot, rapporteur. - Il est possible d'établir des règles préventives sur les actifs échoués.
Jean-Laurent Bonnafé. - Vous ne monterez aucun des projets que nous venons de présenter si vous exigez le même niveau de prévisibilité et les mêmes profils de risque que ceux du secteur pétrogazier. Nous en sommes encore dans une courbe d'apprentissage.
En tant que superviseur, la BCE n'est pas favorable à cette proposition. La prise de risque supplémentaire que représente le passage du brun au vert durera un moment, peut-être quinze ou vingt ans. De fait, même une entreprise aussi sérieuse que Siemens a connu des difficultés importantes avec ses éoliennes, qui sont d'ailleurs très impressionnantes - tout comme le sont les grandes usines de batteries, on n'a généralement pas envie d'y rester très longtemps -, car, en mer, les éoliennes s'usent. Ce ne sont pas les mêmes profils de risque.
Il existe une volonté politique d'accomplir la transition, faute de quoi le monde serait inéquitable, dangereux et inadapté. Il faut donc que les entreprises qui peuvent oeuvrer s'engagent. C'est ce que nous faisons. En vingt ans, notre stock de crédits consacrés au bas-carbone sera passé de 10 % à 90 %. Saura-t-on atteindre les 100 % en 2030 ? Selon M. Jung, à qui je pose tous les jours cette question, certains projets sont un peu têtus. Par conséquent, nous atteindrons cet objectif après cette date. Je préfère assurer que nous ne compterons plus que 10 % de crédits consacrés aux énergies fossiles à cette échéance afin de tenir un objectif réaliste.
Le jour où nos investissements dans le secteur de l'énergie seront essentiellement consacrés au bas-carbone, il me faudra disposer de suffisamment de fonds propres pour pouvoir supporter un profil de risque plus complexe. Quand vous entrez dans un environnement moins connu, il faut passer par un apprentissage, donc par un supplément de capital. Aussi, en tant que banquier, je ne pense pas que l'idée de déshabiller les fonds propres d'une activité soit bonne. Un banquier aime la stabilité. Je trouve équitable de ne pas investir davantage dans les fossiles, mais l'incitation existe déjà, elle est donnée par le superviseur.
Pour les projets nouveaux, tout est à créer. Il n'existait pas d'usines de batteries il y a cinq ans ! Nous avons été la première banque engagée sur le projet Northvolt en Suède, que nous avons structuré. Pour comprendre si nous pouvions nous impliquer, il nous a fallu recruter des agents de haut niveau qui auraient pu être eux-mêmes porteurs du projet : chimistes, mécaniciens, électriciens...
Je ne suis pas un représentant de la Nation, je ne suis pas parlementaire ; BNP Paribas n'est qu'une entreprise, mais une entreprise obéit nécessairement au cadre collectif, qui est, en Europe, la transition. Tout le monde, partout, veut mettre en oeuvre la transition, même si l'expression est différente. Nous proposons pour notre part de transformer rapidement les investissements qui sont au travail dans notre bilan. Un délai de vingt ans est assez court pour atteindre cet objectif sans rendre la vie impossible à l'économie. Aussi, nous donnons seulement une impulsion à nos clients, sans les empêcher de travailler, car, tout en accélérant, le processus doit rester soutenable. Par ailleurs, disons-le clairement, nous n'émettons plus d'obligations conventionnelles dans le secteur pétrogazier. Je l'ai dit, je ne pense pas que cette politique corresponde à la réalité actuelle des entreprises, eu égard à l'analyse des cash flows, mais c'est ainsi, n'en parlons plus !
Quatrièmement, la courbe relative aux investissements dans les infrastructures bas-carbone était d'abord linéaire, montant régulièrement à partir de 2012. Nous avons décidé de divulguer notre trajectoire quand la part de ces investissements a atteint 50 %, afin de montrer qu'elle était vertueuse, puis nous avons accéléré entre fin 2022 et début 2023, et entre fin 2023 et début 2024. En effet, alors que la question restait en suspens, l'Europe a une bonne fois pour toutes classé le nucléaire comme une vraie énergie de transition, la décision dans son principe ayant été prise dans les semaines qui ont précédé le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En pratique, l'État français et Électricité de France, EDF, ont alors donné à nouveau une direction industrielle en matière d'électronucléaire. Un certain nombre d'installations ont été remises en état, une dynamique a été donnée, le parc futur a été repensé.
L'analyse est simple : puisque le nucléaire jouera un rôle plus important, le gaz, qui est l'autre énergie de transition, aura une part moindre. Entre fin 2022 et début 2023, nous parlions pour le gaz d'un ratio de 30 % et d'une baisse de 80 % pour le pétrole, parce que nous ne savions pas dans quelle mesure nous pourrions nous en passer. Une année plus tard, le nucléaire est reparti, malgré les difficultés d'une industrie difficile, dont les investissements seront longs et coûteux. Nous n'avons pas divulgué les chiffres, mais nous réussirons largement à passer sous la barre des 30 %, ce qui nous permettra de parvenir plus vite au bon endroit.
Nos raisonnements et les décisions que nous prenons ne sont pas autonomes, n'étant ni indépendants ni souverains : nous appartenons à la collectivité et sommes pleinement intégrés dans l'économie européenne sous-jacente. La part du gaz se réduit nécessairement à partir du moment où l'Europe indique que le nucléaire est une énergie de transition et que le premier acteur du secteur, Électricité de France, et la France nous assurent avoir un plan de charge pour aller de l'avant. Dans le cas contraire, nous n'aurions pas pu nous fixer un objectif plus élevé. Nous ne nous attribuons donc pas le mérite de l'accélération perceptible entre 2022 et 2024, nous en tenant aux choix qui ont été faits concernant le nucléaire.
L'avantage des infrastructures de gaz, c'est qu'elles sont commutables, comme l'est une bouteille, qui peut être remplie d'eau minérale, d'eau gazeuse ou de vin. La guerre ayant éclaté, le gaz russe est venu à manquer et il a fallu, pour le remplacer en Europe, se tourner vers le seul acteur qui puisse en fournir en quantité, proposant une énergie issue du fracking, de la fracturation hydraulique, ce que personne ne se désirait.
Notre intention n'est pas de financer de façon déterminée et systématique des infrastructures gazières, comme des terminaux ou des bateaux. Notre plan ne le prévoit pas. Je ne pense pas que nous travaillions sur de nouveaux projets de cette nature en ce moment ; en tout état de cause, si c'est le cas, ils ne sont pas nombreux.
Toutefois, compte tenu de la taille que nous représentons dans le système bancaire européen, nous restons prudents. Nous savons que le nucléaire se développera, mais, la montée en puissance du parc n'étant pas simple, une crise demeure possible. Veillant à faire attention, nous ne nous interdisons pas, le moment venu, notamment si la puissance publique nous le demande, d'étudier des projets gaziers, par exemple en cas de nécessité pour des raisons d'indépendance énergétique ou de soutenabilité de l'économie ; je rappelle par exemple que, lors de la crise de 2020, les banques américaines ont été absentes des originations. Sans nous, Dieu sait ce qu'il se serait passé pour un certain nombre d'entreprises.
Néanmoins, financer les infrastructures gazières n'est pas notre choix central. Pour les grands projets pétrogaziers, nous ne sommes plus présents, depuis longtemps, en amont. Ce choix au long cours remonte à 2012. Par nos actions, qui nous placent en bonne position dans le bas-carbone, nous représentons le futur de la banque. Ce constat est vrai pour l'énergie, mais également pour les autres secteurs. Dans dix ans, nos successeurs auront un portefeuille de clients qui correspondra à nos demandes actuelles et non à celles du siècle passé.
Il est donc dans notre intérêt de prendre cette direction. À l'image d'une partie de l'industrie automobile qui basculera vers le tout-électrique, nous nous limiterons purement au bas-carbone. Pour tous les autres secteurs, y compris les plus difficiles - ciment, acier, aviation, etc. -, nous procéderons à un accompagnement. Nous investissons en fonds propres dans des projets relatifs aux carburants qui permettront de répondre aux problématiques.
Je conclus ; je comprends le décalage entre représentation et réalité. L'enjeu pour certains est de tenir un discours politique, relevant de l'encouragement. Peut-être est-il nécessaire ? Quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur nous. Les engagements qui sont pris seront tenus, sauf situation particulière.
M. Yannick Jadot, rapporteur. - Vous avez largement participé au cours de l'histoire aux émissions obligataires de TotalEnergies. Cette entreprise recherchera de nouveaux financements en 2024 et en 2025, une partie de ses obligations actives arrivant à échéance. Au regard de vos propos et des nouveaux projets à venir de TotalEnergies dans le pétrole et dans le gaz, participerez-vous à ces émissions ?
Puisque vous êtes également actionnaires de TotalEnergies, participez-vous directement aux assemblées générales ? Le cas échéant, soutiendrez-vous la résolution portée par une coalition centrée autour du collectif d'actionnaires Follow This, qui vise à demander à l'entreprise d'appliquer les scénarios de l'AIE et ainsi de tendre vers le Net Zero, ce qui signifie d'empêcher le développement de nouveaux projets pétroliers et gaziers ?
Une enquête du journal Le Monde a démontré que de nombreux produits financiers prétendument durables ne le sont pas. Lors d'une audition, le ministre Le Maire a rappelé la volonté de la France, grâce à sa nouvelle réglementation, de sortir les secteurs pétrogaziers des investissements socialement responsables (ISR), eux qui ne sont pas exclus des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Appliquerez-vous cette décision ?
Jean-Laurent Bonnafé. - TotalEnergies nous a invités à participer en avril à une émission obligataire en dollars américains. Nous avons refusé. Il n'est pas dans notre intention de participer à l'avenir à de telles émissions et l'entreprise le sait. Le sujet est clos.
BNP Paribas n'est pas actionnaire en tant que telle de TotalEnergies. De fait, notre banque ne détenant pas de titres de cette entreprise, nous ne votons pas à l'assemblée générale. Certains de nos asset managers, qui gèrent de l'argent pour le compte de tiers, investissent peut-être de manière marginale dans les titres de cette société. La décision leur est propre, la banque n'y participant pas. Je ne peux donc pas répondre à votre question. Je ne suis même pas sûr de connaître le détail des résolutions qui sont proposées.
Naturellement, nous avons vocation à respecter toutes les normes qui s'appliquent aux produits que nous commercialisons.
Mme Laurence Pessez. - À l'heure actuelle, 86 de nos fonds sont classés ISR conformément au label français, pour un montant de 86 milliards d'euros. Parmi eux, 32 investissent dans les secteurs pétroliers et gaziers, pour un montant de 456 millions d'euros. La proportion est donc très faible. La moitié de ces investissements concerne TotalEnergies.
L'objectif de BNP Paribas Asset Management est de conserver au maximum ces labels, ce qui nécessitera des désinvestissements de certains types de sociétés du secteur pétrolier et gazier, dont TotalEnergies fait partie.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - À la suite de la présentation de votre engagement global et plus particulièrement de vos actions tendant à favoriser la décarbonation de dix secteurs fortement émetteurs, je comprends que vous vous montriez comme des banquiers du futur, agissant ainsi pour votre entreprise. En effet, il est évident que le marché vous est assuré : la décarbonation coûtera cher, il faudra des financements. Pour les acteurs de ces dix secteurs et pour tous ceux qui ont des projets verts, bas-carbone ou tendant à la décarbonation, à part créer des indicateurs et donner des objectifs que vous suivez à l'aide de comparaisons avec d'autres banques, que faites-vous ? Parvenez-vous à les convaincre que vous êtes les meilleurs banquiers grâce à vos équipes disposant des bonnes compétences ? Leur prêtez-vous moins cher, sur une durée plus longue ou plus facilement à partir du moment où le projet expertisé est reconnu comme vert ? Vous positionnez-vous simplement comme les meilleurs banquiers, ceux qui sauront le mieux examiner les risques pour prendre les meilleures décisions ?
M. Yannick Jung. - Restons modestes, nous ne prétendons pas être les meilleurs banquiers ! La problématique est nouvelle, le secteur se développe vite et nous avons beaucoup à apprendre. Nous aidons nos clients à différents stades de développement.
Le constat est vrai dans le domaine de l'énergie. BNP Paribas a été aux côtés de la plupart des plates-formes d'énergies renouvelables qui ont émergé en France pour les aider à lever du capital ou à s'introduire en bourse afin de poursuivre le développement de leur activité en le finançant.
La remarque vaut pour les nouveaux modèles économiques qui émergent autour de l'hydrogène ou, plus généralement, dans la chaîne du bas-carbone. Toute une série d'opérateurs de réseaux de bornes de recharge pour les véhicules électriques s'est tournée vers BNP Paribas pour les aider à faire un tour de table afin de financer une nouvelle phase de leur développement.
Nous intervenons également sur des projets qui ont atteint un certain degré de maturité, apportant des conseils aux entreprises sur la meilleure façon de poursuivre leur développement et de structurer leurs levées de fonds. Des sources d'investissement nombreuses et diverses peuvent exister : Bpifrance, financements à l'export, fonds sur projet, ou, au contraire, apports de longue durée en provenance du marché obligataire...
De nombreuses usines de grande taille relatives à la production de batteries équipant les véhicules électriques sont montées sous forme de financement de projet. Pour ce faire, nous formons un syndicat bancaire, comme dans le cas d'Automotive Cells Company (ACC) ou de Northvolt. En l'occurrence, sur ces deux projets, la banque qui a développé un certain savoir-faire en la matière, qui a aidé à structurer le financement, à le placer auprès d'autres banques, à l'expliquer à ces dernières ainsi qu'à les rassurer sur la nature des risques était BNP Paribas.
La remarque vaut aussi pour le secteur de l'acier vert. Nous travaillons actuellement sur des projets d'aluminium durable, de capture et de séquestration de carbone, que ce soit directement dans l'air ou à la sortie de la cheminée de l'usine d'un cimentier. Chaque fois, nous essayons de trouver la solution permettant à ces grands acteurs industriels de financer leur transition énergétique.
Nous aidons également les ETI. Je mentionnais notre groupe de 200 banquiers spécialisés, provenant pour la plupart du secteur de l'énergie, de la chimie et de l'industrie, assistant nos clients dans cette transition ; nous menons une initiative équivalente au niveau local dans cinq de nos réseaux européens, à savoir en France, en Belgique, en Italie, au Luxembourg et en Pologne, où nous sommes très présents auprès des TPE et des PME. Nos banquiers dédiés se tournent vers ces dernières pour les aider à trouver des solutions.
La transition est en effet très coûteuse. Nous parlons de milliers de milliards d'euros d'investissements à prévoir chaque année sur les vingt à trente années qui viennent. Nous pouvons apporter une petite partie de ces besoins à l'aide de notre bilan, mais il n'est pas extensible à l'infini. Une partie de notre savoir-faire est dans le fait d'aller trouver des sources de financement dans les marchés publics : bourse, marché obligataire, investisseurs institutionnels, autant d'acteurs qui sont prêts à prendre des risques industriels sur le temps long.
M. Roger Karoutchi, président. - Je vous remercie pour cette audition extrêmement intéressante.
Cette audition a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 17 h 25.